MAC ORLAN Pierre, Verdun, Paris, Nouvelles Éditions du Siècle, 1935. 160 pages.
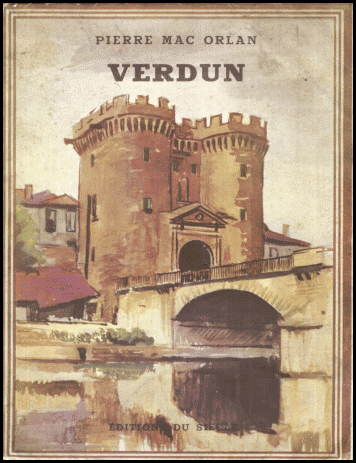
Cet ouvrage est particulier : c’est quand on le feuillette rapidement, un guide des principaux lieux liés à la bataille de 1916. Le choix des photographies et de la couverture nous donnent cette illusion. Quand on commence la lecture, on comprend qu’il n’en est rien. Il s’agit des mots d’un homme ayant combattu à Verdun.
Il nous plonge à la fois dans son expérience de combattant, mais aussi dans son expérience d’ancien combattant revenant sur les lieux 20 ans plus tard.
Et ce combattant n’est pas n’importe qui : même si son expérience vaut celle de chacun des hommes mobilisés, il n’en reste pas moins que Pierre Mac Orlan est un écrivain remarquable par son style, la richesse de ses descriptions et de ses souvenirs.
- Première partie : 1916
Il fait un récit chronologique de son passage à Verdun depuis les villages de l’arrière jusqu’à la zone des combats. Étrangement, si la montée est nette et précise, riche en anecdotes et en descriptions, la période au front est très réduite. L’auteur s’en explique : « Devant le bois de la Caillette, j’étais âgé de trente-deux ans. A cet âge les souvenirs sont déjà choisis. Il était trop tard pour que je puisse découvrir le sens anecdotique de la guerre », page 23. Il explique par ailleurs que ce fut une parenthèse : « Pendant près d’un mois, devant Verdun, nous fûmes en proie au délire », page 22. De ces délires qui faisaient accepter la légende des gendarmes assassinés.
« Je suis donc lié à Verdun par des images d’un intérêt personnel puissant », page 25. C’est par cette phrase que commence la narration de ses retours sur place. Il précise y être retourné quatre ou cinq fois. Il s’interroge sur la place de cette bataille dans le parcours de chacun. « Verdun diminua encore, si possible, la pauvre personnalité de chacun de nous. C’était un creuset ardent où l’on culbutait pêle-mêle : hommes, chevaux, mulets, canons, boites de singe, vieilles lettres familiales ou d’amour ou argent de poche », page 25.
Sa remarque page 26 est également très intéressante : « En dehors du secteur de combat, dont je ne peux rien dire, car c’est pour moi aussi difficile à décrire qu’un choc au cerveau ! ». Elle introduit sa présentation de la ville de Verdun. Cette description, cette visite plutôt, il l’a faite au travers des hommes. Il en profite d’ailleurs pour noter l’absence de haine vis-à-vis des Allemands. « Quelques mystiques haïssaient les Allemands – ceux-là furent sans doute les plus heureux parmi tous les croyants qui moururent dans ce grand mouvement de la nature », page 27. Il poursuite page 28 : « A Verdun commença réellement la fin d’un monde et ceux qui vécurent là, en février 1916, purent constater que la guerre était la plus terrifiante de toutes les maladies de l’intelligence humaine. C’est pourquoi nous ne haïssons pas l’ennemi, tout en essayant de le détruire. »,
Il évoque la richesse et la pauvreté au régiment page 30 puis explique : « Il est peut être, non facile, du moins possible de se préparer à la mort, une fois pour toute, mais il est inhumain de recommencer cette opération philosophique à peu près tous les trois jours. Pour cette raison, plus le soldat coud de brisques sur sa manche et moins il s’aguerrit ». Il continue ses observations : le jeune craint moins la mort que le vieux, la plupart vont se battre avec résignation, peu savent réellement se battre : « la majorité fait le sacrifice de sa vie par ordre, par patriotisme et par ce « je ne sais quoi » qui est la conscience traditionnelle du soldat », page 31.
L’impossible solitude et l’aventure sont abordées « Cette foule immense de soldats – citoyens sacrifiés quotidiennement dans la gueule immense de la monstrueuse divinité qui, chaque jour, dévorait des milliers d’hommes », page 35. Ce sont des réflexions que Mac Orlan développe avant de décrire la marche sur la route de Bar-le-Duc après trois semaines en ligne, dont il ne dit mot. « Il fallait attendre quelques années pour retrouver dans notre mémoire cette chronique fantastique de mars 1916 ».
- Deuxième partie : La route
Cette partie commence par l’évocation de « la route ». Cette route qui partait de Paris pour rejoindre l’Allemagne. Il l’évoque avant-guerre, route des camps de Champagne ; en 1914, route du début de la guerre. Cette route, Mac Orlan la recentre sur lui ensuite. Il parle d’un « essai sentimental ». Cette route est celle de son expérience personnelle d’ancien combattant. Il écrit page 51 « je suis parti seul, comme il est nécessaire de le faire quand on veut se mêler intimement à un passé difficile à expliquer pour des raisons sentimentales qui n’ont d’intérêt qu’autant qu’elles peuvent s’associer à une solitude bien délimitée ». Après une évocation littéraire et historique, la narration d’un moment passé dans une guinguette nous montre l’importance de ce moment pour ces hommes, à quel point ils sont marqués et l’importance d’être entre eux. Eux seuls peuvent comprendre : ils sont dans une bulle faite de souvenirs, une image, un chant, un lieu… Dans la discussion, les hommes expriment les raisons de leur venue solitaire, après des essais infructueux de partage avec leur famille.
Le champ lexical de la guerre est omniprésent : une motocyclette fait « un tapage assourdissant de mitrailleuse ». Les hauteurs de Verdun ont connu « une tenace offensive de la nature ». La ville de Verdun est « à peu près immobilisée dans une page d’histoire ». Pour conclure, entre ces hommes « qui tentaient de prolonger une jeunesse » et « des femmes en deuil », il note « On va à Verdun une fois, on revient à Verdun. Il est impossible de se libérer de Verdun ».
- Troisième partie : Le secteur
Dès les années 30, le portrait des lieux dressé par Mac Orlan a de quoi surprendre : « Je me désespère de voir l’herbe repousser par endroit. Autrefois, il n’y avait point d’herbe. Il faut venir visiter les forts en hiver quand la neige recouvre le champ de bataille. Ainsi ceux qui désirent se faire une idée de ce que fut la campagne autour de Verdun pourront conserver un souvenir honorable de leur pèlerinage » note-t-il de la bouche d’un guide pages 69-70. Il constate qu’il n’a pas le même ressenti : la solitude « nourrit ce lyrisme de Verdun qui n’est pas celui des foires officielles, où la patriotisme n’apparaît qu’à la manière d’une attraction bruyante et médiocre », page 70.
Les thématiques évoquées par Mac Orlan sont variées. « Quand je veux écrire sur ces années en guerre que j’ai vécues, à Verdun ou à Souchez, qui valait bien Verdun, je ne peux réunir autour de moi que des fantômes. Pour évoquer les soldats avec émotion, il me faut évoquer leurs ombres ». Il présente les anciens combattants comme hantés, accompagnés par les camarades disparus. Il précise son idée : le temps efface très vite les souvenirs : « Il est difficile pour moi de me rappeler la réalité des événements », page 72. Il évoque aussi la mort, toujours présente, avec « les engins [qui] poussent comme les chardons et les bardanes » et continuent de tuer. Les villages rayés de la carte et non reconstruits, Mac Orlan explique ce choix à sa manière : « par la seule volonté des morts qui n’admettent pas que les filles aillent danser à la frairie, à l’endroit où ils se sont vidés de leur sang comme des outres percées ». page 73. Page 74 il ajoute « Des écriteaux nombreux signalent prudemment que la mort n’a pas abandonné ce royaume. Les vieilles habitudes lui sont chères et aucune puissance humaine ne pourra l’obliger à déguerpir de ce coin qu’elle aime ».
Il décrit la rive droite, à commencer par le changement du fort de Vaux qui « n’est plus qu’une cave démolie » dont il note la réfection « prête pour l’avenir ». Il évoque le lion du monument élevé par l’Association des anciens de la 130e DI et les combats qui se déroulèrent à la Haie au Renard en août 1916. Il mentionne sept zouaves qui défendirent seuls le lieu et en profite pour égratigner Norton Cru sous-entendant qu’ils « gardèrent de la guerre une tout autre image que celles que M. Cru considère comme seules dignes de créance, grâce à sa discrimination » page 77. Il donne également son avis sur la sacralisation du champ de bataille « Et c’est bien ! Merveilleusement bien ! Il faut que cette terre reste à jamais stérile, un exemple de stérilité, à l’abri des panneaux-réclames, des dancings et de la joie de vivre en plein air. Le mot : silence est écrit partout, en toutes les langues, dès le seuil du grand ossuaire gonflé de rêves inachevés et de méditations éparpillées », page 79.
Il développe longuement une métaphore sur la famille qui aime le sucré et celle qui aime le salé pour montrer ces petits riens qui mettent les peuples dos à dos. « Les grandes fureurs collectives provoquées par un patriotisme trop héréditaire sont souvent l’expression spontanée d’une petite sottise nationale adroitement transportée et exploitée » page 85.
Autre point abordé : la religion. « Nous nous contentions de prier la chance. Certains le firent en se rappelant, en certaines circonstances, les formules religieuses de leur enfance. Ils firent à Dieu des promesses qu’ils ne tinrent pas quand la paix fut signée », page 91. Il revient sur les légendes. Pour celle de la Tranchée des baïonnettes, il donne une version inexacte de la réalité, celle des fusils alignés et d’hommes enfouis dans les abris. Pour ce qui est des espions, il écrit « Après la guerre ces légendes se composèrent plus littérairement. Je n’ai pas encore rencontré un soldat qui ait vu les fameux gendarmes accrochés dans la boucherie rouge, du côté de la rue du Mont-de-Tilly. Tout ce que l’on peut dire, c’est que ce spectacle savamment horrible, vrai ou faux, ne nous paraissait pas anormal », page 93.
Les pèlerins, pour Mac Orlan, ce sont les anciens combattants et leur famille, « de vieilles gens que rien ne saurait consoler et qui ne demandent même plus d’explications, car ils pensent désormais savoir à un mètre près, l’endroit où est tombé leur fils », page 94. C’est aussi l’occasion de revenir sur l’ossuaire : « La plupart de ceux qui sont là ont imaginé, détail par détail, la mort du soldat dont ils reviennent ici chercher la présence sous la terre » pour arriver au constat : « D’année en année, ceux qui reviendront à Verdun seront de moins en moins nombreux. Les rangs s’éclaircissent déjà. D’autres qui nous suivent verront mieux dans ce genre, car c’est le destin de l’humanité de se détruire périodiquement avec la plus furieuse incohérence » page 96.
Plus factuel, il décrit le travail pour retrouver les corps, la venue des touristes plus Allemands ou Belges que Français.
- Quatrième chapitre : La ville
Même lorsqu’il évoque Verdun en tant que ville, Mac Orlan y va de ses réflexions. Très vite, il aborde la question des patriotismes provinciaux et rappelle quelques anecdotes à ce sujet. La guerre est toujours présente. Sa description de la ville part des principales rues, casernes pour évidemment s’arrêter sur l’accueil des anciens combattants. Il écrit page 109 « … Verdun, jolie fille bien portante dans ses voiles de deuil : « Allons ma belle, il ne faut pas pleurer » ». Cette phrase résume parfaitement les difficiles adaptations d’une ville simple aux nombreuses casernes qui côtoie et porte le nom d’un tel champ de bataille.
Sa réflexion s’éloigne de Verdun peu à peu. Il note longuement ses réflexions sur « comment vient la guerre » page 113. « La guerre m’apparaît comme une maladie contagieuse (…). » Comme souvent dans son livre, Mac Orlan, une fois sa longue parenthèse fermée (parenthèse dans laquelle il parle aussi de Verdun!), il revient au sujet de Verdun. Il évoque longuement la citadelle, se remémorant, pendant la visite, l’impression qu’il avait eue en 1916.
« Verdun, ville historique, est une ville simple à la lisière d’un paysage atrocement dépouillé par la volonté des hommes. Ceux qui dorment dans le sol bosselé, recouvert maintenant d’arbustes malades, entre deux collines sombres (…), étaient des gens simples, de « petite extrace » » page 125.
- Cinquième partie : A l’usage du touriste sentimental
Cette partie est celle qui ressemble le plus à un guide touristique : explications historiques sur la route de Sainte-Menehould à Verdun, la porte-chaussé, la cathédrale et le quartier ecclésiastique. Mais il arrive à faire des digressions. La plus notable est celle qui l’amène à écrire sur la mobilisation des animaux et à décrire le sort de deux chiens adoptés du régiment. Il évoque les chevaux, ânes, chiens, chats, pigeons, rats et corbeaux, martinets et geais. Cette digression finit par être plus longue que le reste du chapitre !
Il termine sa présentation de la ville par les boutiques qui vendent « toute une collection en divers métaux de bornes voies sacrée, d’encriers, d’obus-briquet, ou vase à fleurs, de casques de mitrailleuses Hotchkiss, de canons de 75 presse-papier et de réductions des principaux de la ville et du secteur » page 149.
Sa conclusion montre que si la guerre est toujours possible, Verdun reste une empreinte indélébile pour ceux qui y sont passés « Mille pèlerins cherchaient, comme moi, sur la terre, stérile, le point précis d’un abri, d’un dépôt de munitions où ils avaient dû enfouir, sans espoir de les retrouver un jour, leurs habits civils et leurs projets d’avenir », page 154 : Verdun reste symboliquement le moment le plus important de nombreuses vies. Ceux qui y sont morts mais aussi pour ceux qui y ont passé des moments qui les ont marqués à jamais.
Les dernières pages, dans une taille de caractère plus petite, donnent quelques conseils aux touristes, en restant bien dans le style et l’esprit du reste de l’ouvrage. « La mélancolie de cette terre ravagée se dégage mieux dès que l’on abandonne le bord des routes ».
- En guise de conclusion
Cet ouvrage n’est pas réellement un guide. S’il en a la forme, la structure, les illustrations, il n’est en fait qu’un prétexte pour l’auteur. Mac Orlan y narre sa propre expérience, sa vision d’ancien combattant autour de ce lieu si particulier. La mort, la mélancolie, l’incompréhension, sous des formes littéraires, sont présentes partout. Une belle manière pour nous, à un siècle de distance, d’appréhender le trauma qu’a été cette expérience et le lien fort qui unissait nombre d’anciens combattants avec les lieux.
Avec sa vision particulière, mélancolique, parfois critique, ironique, Mac Orlan offre un aperçu de Verdun par un observateur qui fut aussi acteur de la bataille. Il le fait avec son talent d’écriture habituel. Dans un texte rempli de sensibilité, de tristesse, d’émotion, il livre sa vision particulière du lieu.
« dès que le dernier témoin de l’agitation affreuse qui anima ce bled sera conduit dans sa tombe, la haute domination mélancolique de Verdun disparaîtra, car nous ne sommes pas des mystiques » écrivait Mac Orlan page 98. Concernant les souvenirs achetés à l’époque, il écrit aussi « Dans un siècle, tous ces petits objets prendront une valeur qui leur ouvrira des portes de vitrines qui, aujourd’hui encore, leurs sont interdites », page 50.
Maintenant que le dernier témoin de Verdun a disparu, qu’un siècle est passé, il serait intéressant de comparer ce que Mac Orlan imaginait et la réalité de cette décennie 2020.
Autre ouvrage de Pierre Mac Orlan :
– Les poissons morts https://combattant14-18.pagesperso-orange.fr/Representer/EC01MacOrlan2.html
