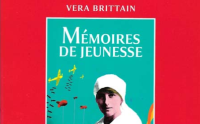BRITTAIN Vera, Mémoires de jeunesse, Paris, Viviane Hamy Éditions, 2023, 721 pages.
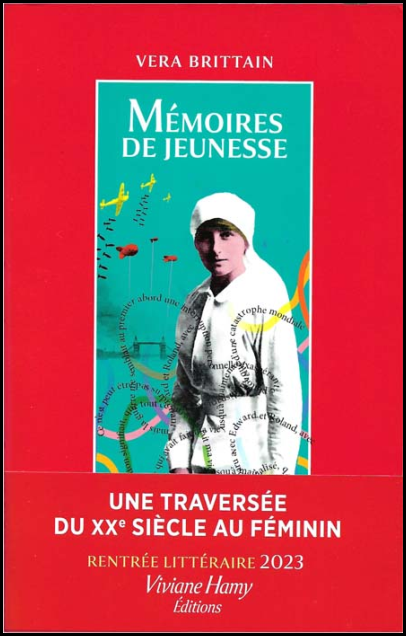
Je ne me lasse pas de m’étonner que ce chef-d’œuvre de la littérature anglaise n’ait pas été traduit en français avant 2023 ! Vendu à des centaines de milliers d’exemplaires outre-Manche, il n’avait jamais fait l’objet d’adaptations autres que des films pour le public hexagonal.
La présente édition n’offre aucune introduction ou élément de contextualisation ou critique. Il s’agit uniquement de la transcription de l’œuvre.
L’ouvrage n’est pas une simple biographie. C’est à la fois une narration des étapes de sa vie enrichie de ses notes personnelles sur son ressenti et un formidable coup de projecteur sur la société et la vie civile anglaise.
- Vera Brittain, une jeune femme dans la société victorienne
L’autrice, née en 1893, commence sa narration par ses souvenirs d’enfance, au début du 20e siècle dans une Grande-Bretagne puissante. Tout est fait pour mettre en avant l’enfance paisible qui ne prépare en rien aux tourments que sa génération va traverser avec la Grande Guerre. C’est en tout cas un propos qui revient dans pratiquement chaque chapitre au début du récit.
Elle est la sœur d’Edward, de deux ans son cadet. Elle appartient à une famille de moyenne bourgeoisie comme elle le décrit elle-même, à la tête d’une fabrique de papier et ayant une domesticité. Sa jeunesse avant-guerre est celle d’une jeune fille qui cherche à desserrer le carcan d’une société trop figée pour elle. Elle décrit la construction de sa vision de la vie, de la culture, ses combats féministes et agnostiques, son ambition passant d’abord par la lecture puis par les études et l’université. Les premiers chapitres forment un aperçu critique de la société bourgeoise anglaise du début du 20e siècle dont elle cherche à se défaire : le mariage puis la soumission à son mari n’est pas son objectif de vie.
Ce livre est aussi l’occasion d’exposer ses idées sur de nombreux sujets, y compris l’importance de l’enseignement. Elle note page 34 : « J’ai le sentiment que le désir de penser – qui est un problème d’ordre moral à la base – doit être stimulé avant que cette faculté le soit. (…) penser relève d’un processus éminemment inconfortable qui apporte au sujet plus de souffrance que de bonheur dans un monde à demi civilisé seulement, où l’on fait encore la guerre, où l’on encourage des femmes épuisées à mettre au monde des enfants non désirés et où l’on contraint des couples qui se détestent à vivre ensemble au nom de la moralité ».
Elle cherche, avec ses mots et son autobiographie à rappeler ce qu’était la vie d’une jeune femme mais aussi de cette jeunesse qui, par définition passe, mais qui ici a été fauchée, interrompue sans pouvoir donner les fruits individuels espérés. Page 46 elle explique « tant de ces jeunes fats avaient conquis leur dignité en trouvant la mort en France ou aux Dardanelles que je vis le souvenir de ces danses le vestige incongru d’un monde disparu depuis longtemps et à demi oublié (…) ». C’est bien le sens premier de ce « testament » en anglais, c’est-à-dire la « mémoire » en français qui au témoigne d’une période souvent effacée au profit de la parenthèse guerrière qui a écrasé ces jeunes comme leurs souvenirs. Elle veut faire ressurgir ces souvenirs et le succès du livre montre que beaucoup partagèrent sa démarche.
Puis arrivent le printemps et l’été 1914 : c’est le temps de la réussite aux concours de bourse et d’entrée à l’université mais surtout la rencontre avec Roland. Le coup de foudre réciproque est immédiat, mais on suit les turpitudes de leur relation dans les convenances de l’époque. En parallèle, la situation internationale se dégrade jusqu’à la déclaration de guerre qui coupe toutes les ambitions. Mais ses premiers pas à Oxford lui font oublier la situation générale jusqu’à ce que son frère Edward devienne sous-lieutenant au 11e Régiment de Sherwood Foresters. Seul le départ prochain de Roland après leurs rares rencontres, toujours chaperonnées, lui fait comprendre l’intensité de ses sentiments et l’angoisse quotidienne qu’est la peur de perdre l’être aimé. La guerre, encore lointaine, devient éminemment concrète pour la jeune femme.
- Entrées en guerre
Le départ de Roland le 31 mars 1915 pour la France marque un tournant à la fois dans les carnets de Vera Brittain et dans son analyse. Elle a tenu un journal avec beaucoup de soin. Conservé, il sert de base à de nombreux passages de son récit qu’elle commente et analyse ; elle a aussi conservé précieusement tous les courriers échangés. Intéressants pour observer la construction d’une jeune femme dans la société bourgeoise du début du 20e siècle, ils deviennent incontournables dès l’instant que la guerre s’immisce concrètement entre Vera et Roland. Elle exprime dans son carnet comme dans son analyse des sentiments partagés par les familles mais rarement mis en mots, en tout cas rarement aussi bien expliqués.
Il y a d’abord l’insoutenable attente de nouvelles qui quand elles arrivent sont déjà vieilles de plusieurs jours et qui finalement n’enlèvent pas l’affreux doute.
- Avec les infirmières
Décidée à participer à la guerre afin de partager ce que vit son Roland, elle s’engage comme infirmière VAD1. On suit à la fois l’organisation de cette structure et le quotidien de Vera Brittain dans chacune de ses affectations. D’abord affectée près de chez elle, elle demande à rejoindre Londres. On suit ses taches quotidiennes, la description des hébergements, la gestion du temps libre et des repos, la hiérarchie… Ensuite, elle rejoint une unité à Malte en septembre 1916. Une fois encore, elle ne se contente pas de narrer le trajet, elle nous immerge dans son état d’esprit, la peur de couler pendant le trajet, les règles des supérieures intransigeantes. Après sa démission et un séjour à Londres, elle décide de rejoindre à nouveau le corps des infirmières et est affectée en France. C’est l’occasion d’une nouvelle série de portraits et d’anecdotes. Elle ne manque pas non plus de décrire ce qui l’entoure, d’autant qu’elle est d’abord dans un service de blessés allemands puis dans un bloc chirurgical. Autant les descriptions de Malte étaient bucoliques et assez lumineuses, autant celles d’Étaples sont sombres et boueuses. D’ailleurs elle associe symboliquement la période de la guerre à un hiver (page 401).
On perçoit un changement dans ses écrits ; désormais, elle axe plus son récit sur son expérience d’infirmière que sur ses pensées et ses réflexions personnelles. La perte de Roland et de ses deux amis passe un peu à l’arrière-plan, le temps passe. Page 428, elle décrit de manière détaillée les effets de l’Ypérite, les chances de survie des touchés, les symptômes. On est au cœur des alertes aériennes ainsi que des combats de mars avril 1918 qui se rapprochent dangereusement d’Étaples. C’est à ce moment que sa famille demande son retour en urgence suite à la dépression nerveuse de sa mère et à la difficulté de trouver de la domesticité. Elle réussit à casser une deuxième fois son contrat de VAD et rentre à Londres qu’elle trouve engluée dans les pénuries quotidiennes. Elle est écœurée par les plaintes des civils qui oublient ce que subissent les mobilisés ou les infirmières, leur sacrifice (de leur vie comme de leur jeunesse). D’ailleurs cela lui devient tellement insupportable qu’à l’été elle contracte un nouvel engagement de VAD.
Envoyée cette fois-ci dans un hôpital civil, elle ne cesse d’en critiquer les usages des VAD qui sont reléguées aux tâches les plus basses sans tenir compte de leurs expériences. Elle finit par réussir à retourner dans une structure militaire où elle apprend l’armistice.
- Vivre « après »
Vera Brittain évoque d’abord ce qu’est vivre après la disparition de l’être aimé. Décembre 1915, alors qu’elle se prépare à retrouver Roland lors d’une seconde permission huit mois après leur dernière entrevue, Vera Brittain narre son quotidien fait d’impatience, de légèreté. Mais cette première partie du livre s’achève en même temps qu’elle apprend la nouvelle : il est mort le 23 décembre, veille de son départ en permission. Commence un « après » qui s’étire tout au long de la deuxième partie du livre.
Vera Brittain n’épargne aucune étape de sa tristesse qui suit l’annonce de la mort de son fiancé : d’abord la recherche des circonstances de sa mort en écrivant à tous ceux qui pourraient l’informer. Ensuite, le regard des autres, les soutiens des amis fidèles et des familles (la sienne et celle de son fiancé), les mois passés à réfléchir, à faire face à ses émotions. Elle ne sort d’une spirale dépressive que grâce à une coupure liée à une grippe. Le déclic, symbolique, est visible : elle se remet à écrire où elle exprime clairement ses ressentis et en tire une conclusion à laquelle la Vera Brittain qui écrit 15 ans plus tard répond, page 289 :
« « Je me demande si je pourrai recouvrer un jour
L’humeur de ce matin de mai, il y a si longtemps. »
La réponse à cette spéculation finale est tombée aujourd’hui, non seulement pour moi mais pour toute ma génération : nous n’avons jamais retrouvé cette humeur et nous ne la retrouverons jamais. » : la guerre a brisé une génération et cassé sa jeunesse.
Elle illustre également ce secret espoir de revoir le soldat décédé. Comme d’autres personnes, elle rêve de Roland. Voici l’un de ses rêves : « Il y avait maldonne, nous disait sa lettre. Il n’était pas mort, il était prisonnier en Allemagne, mais si effroyablement mutilé qu’il ne pourrait jamais revenir. Aussitôt, j’étais envahie d’un soulagement immense à l’idée qu’il soit finalement vivant, quelles que soient les circonstances (…) », page 293. Ce rêve revint une dernière fois en 1924 lors de la longue attente avant son mariage page 708 :
« j’eus à peu près à cette époque pour la dernière fois l’un de ces cauchemars de peines et de morts du passé qui, pendant dix ans, avaient hanté mes nuits. (…) je me suis retrouvé confrontée à une situation à la Enoch Arden2 (…) car j’avais rêvé que (…) des nouvelles arrivèrent annonçant que Roland n’était pas vraiment mort, mais avait seulement été porté disparu et avait perdu la mémoire, et maintenant, après des souffrances indescriptibles, il était rentré en Angleterre. Dans mon rêve, sa famille m’invitait chez eux pour le revoir ; j’y allais, et ne le reconnaissais pas tant sa cruelle expérience l’avait changé, mais ses intentions à mon égard étaient toujours les mêmes, souhaitant vivement m’épouser (…).
Et puis, dans un sursaut de soulagement, je me souvins qu’aucune résurrection ne viendrait compliquer les relations entre hommes et femmes déjà tributaires de leurs aléas terrestres. Il n’y avait qu’un court moment entre la nuit et le néant pour remplir des obligations, tant envers des individus que de la société, et qui ne pouvaient être remises à plus tard dans le confortable avenir d’un paradis rédempteur. »
Son frère Edward est blessé le 1er juillet 1916 lors de l’offensive de la Somme et est rapatrié, par hasard, dans la structure où travaille sa sœur. Mais elle doit rapidement le quitter en raison de son départ pour Malte. L’écriture marque une césure nette : elle quitte son enfermement londonien et sa dépression pour ressortir au grand air et revivre. Si l’absence de Roland est toujours présente, elle ne l’est plus qu’en filigrane. Elle décrit la lumière, les fleurs, la mer qui font de son séjour à Malte une parenthèse particulièrement marquante.
Vera Brittain est ensuite touchée par trois autres deuils, chacun étant l’occasion de réflexions. Ses mots lui permettent aussi d’observer une adaptation, une résignation face à ces drames.
Au-delà de l’incertitude du sort des hommes au front vécue par une civile, c’est la répétition des deuils qui est frappante. Pour Vera Brittain, ils s’enchaînent : d’abord son fiancé en décembre 1915, puis ses deux plus chers amis Geoffrey et Victor en 1917 avant le décès de son frère en août 1918. Il y a un « yo-yo » émotionnel particulièrement visible, les périodes de vies étant toujours brutalement coupées par l’annonce d’un décès qui précède alors une profonde période de déprime avant un regain qui s’interrompt systématiquement. Et cette impression que chaque descente empêche ensuite de revenir à l’état de départ, expliquant ce fil rouge de l’ouvrage, cette jeunesse insouciante et pleine d’avenir disparue. Ses mots, ce désespoir en observant toute cette jeunesse gâchée, sacrifiée, on les retrouve chez peu d’auteurs, jamais aussi développé. En France, un seul nom me vient immédiatement en tête : « La jeunesse morte » de Jean Guéhenno.
Apprenant la grave blessure de son ami Victor, elle décide de quitter Malte et de rentrer en Angleterre. On suit son périple à travers l’Italie, la France et les retrouvailles avec son ami. Mais il décède très rapidement après.
La mort de son frère est la quatrième dans le cercle immédiat de Vera Brittain. Mort le 16 juin 1918, l’annonce plonge l’autrice dans un profond désespoir car c’était son dernier soutien. D’ailleurs la Vera Brittain qui écrit 15 ans plus tard ne manque pas de noter qu’elle ne s’est jamais remise de la mort de son frère. Cependant, la mort d’Edward ouvre une période de questionnement mais pas d’enfermement ou de repli sur soi comme ce fut le cas des précédents deuils. Faut-il y voir une accoutumance ou une préparation psychologique fataliste quant au destin tout tracé de son frère ?
Dans l’après, il y a aussi l’après-guerre. Vera Brittain n’éprouve aucune joie. Les étapes qui mènent à la paix sont franchies dans une indifférence complète de sa part. Le récit s’intéresse à sa réadaptation à la vie et nous montre sa difficulté. Si elle retourne à Oxford finalement, c’est une étudiante isolée, aigrie contre les jeunes étudiants qui reprend goût à la vie lentement. Ce sont de longs mois, où les relations humaines sont rares, les conflits concernant l’engagement de sa génération face à la nouvelle jeunesse sont réguliers. Vera Brittain a deux amies dont l’une, Nina, décède. Sa réaction est étonnante mais elle l’explique ainsi : « Je la chassai de mes pensées et m’adonnais furieusement aux parties de tennis avec Mary, car j’en avais plus que soupé de la mort et de perdre des proches », page 525. C’est en fait une femme traumatisée qui a été profondément marquée par la guerre sans réussir à tourner la page : plus rien n’est comme avant, plus personne n’est là. Entre incompréhension vis-à-vis de ceux qui n’ont pas traversé ce qu’elle a vécu et travail personnel pour avancer et surmonter le traumatisme, elle illustre le retour à la vie de cette génération. Elle est consciente que sa santé mentale fut sur le fil en 1919-1920, elle évoque même « le fil ténu de la folie », page 539 lorsqu’elle évoque ses hallucinations. Elle finit par ne plus parler publiquement de son parcours et trouver en Winifried Holtby, d’abord une antagoniste puis l’amie fidèle et la confidente nécessaire pour parler, redonner du sens à la vie.
Sa description de l’envie irrépressible de vivre vite tant on sait que cela peut s’arrêter brusquement définit les survivants qui intègrent l’université en 1919. Même Vera Brittain manque de tomber dans ce tourbillon en étant fiancée brièvement à un étudiant.
Toutefois, ses écrits sont à nouveau militants – féministes – après la parenthèse de la guerre. Elle subit certaines inégalités mais vit aussi l’octroi de nouveaux droits, comme celui de recevoir un diplôme à l’université. Elle mène à bien ses études qu’elle achève à 27 ans.
L’après est évidemment marqué par le pèlerinage en 1921, une fois les fonds nécessaires mis de côté, sur la tombe de son frère en Italie et de Roland en France. Une fois encore, les années sont passées : si l’émotion est toujours présente, son deuil est fait, ses mots sont moins forts, moins désespérés. Un cap a été franchi, celui de réussir à vivre malgré tout. Ici, le voyage en Italie est un mélange entre ce pèlerinage et du tourisme culturel.
Ensuite, cherchant à devenir romancière, elle cherche des emplois pour financer sa colocation avec Winifried à Londres, symbole de son indépendance vis-à-vis de sa famille. Donnant des cours d’Histoire dans des établissements scolaires, elle cherche à vivre de sa plume à côté. Toujours féministe, elle s’engage progressivement dans la lutte politique jusqu’à devenir une oratrice parcourant le pays pour développer ses idées sociales après avoir lutté pour la paix.
Elle construit en parallèle sa carrière littéraire et nous fait partager les difficultés et les questionnements qui les accompagnent.
- Un livre souvenir qui dit le traumatisme
Poèmes, extraits de correspondance, documents accompagnent le récit, comme autant d’hommages à ces hommes disparus, ici pour son frère, son fiancé et ses deux amis. Ce n’est pas juste un récit reposant sur des souvenirs. Il est richement documenté grâce à ses écrits quotidiens dans son journal intime et les correspondances échangées récupérées3. Cette matière permet un récit d’une exactitude rare, parfois relatant des faits précis et des idées au quotidien. Toutefois, des passages sont passés sous silence habilement afin que chaque partie permette de développer une thématique, une période particulière.
Certains passages sont aussi surprenants, par exemple quand dans un courrier à Roland de septembre 1915 elle note, pensant à ce qu’elle ferait si elle apprenait la mort de son fiancé « J’ai souvent des moments de désir effréné d’écrire, peu m’importe quoi, sauf des futilités qui ne me satisferaient pas. Pourrais-je écrire un roman autobiographique ? Je me le demande. Peut-on faire un livre à partir de l’essence même de soi ? Peut-être bien, si l’on se retrouve avec son seul don dépouillé de ce qui le rendait précieux, s’il représente tout ce qu’il reste… », page 206. La mise en abîme est vertigineuse et fort bien amenée.
Dans d’autres cas, elle permet de mettre des mots sur des impressions, sur des idées qu’on peut se faire. Par exemple page 229, elle explique « Je n’avais pas encore pris conscience, cela me viendrait plus tard à travers ma propre reddition mentale, que seul un processus d’adaptation complet, qui oblitère les goûts, les talents et même les souvenirs, rend la vie supportable à qui doit faire face à la guerre dans ce qu’elle a de pire. (…) la guerre prenait intégralement possession de la personnalité sitôt qu’on franchissait la mer (…) ».
Page 403, c’est la vision d’une civile sur les ennemis qui transparaît. Même si elle note ensuite qu’elle ne savait pas trop s’il fallait s’y fier, les rumeurs sur les ennemis étaient connues et forgeaient une partie de la vision que l’on pouvait avoir d’eux. Elle explique alors qu’elle est désignée pour servir dans la section des prisonniers : « représentants d’une nation qui, comme on me l’avait répété tant de fois, avaient crucifié des Canadiens, coupé les mains de bébés, et soumis des femmes pures et sans taches à des atrocités innommables. », page 403. Mais il y a alors la vision de la réalité, de l’égale souffrance dans les deux camps et de la destruction des jeunesses dans des buts incompréhensibles.
Elle évoque aussi à plusieurs reprises ses retours sur les lieux entre la fin de la guerre et l’écriture du livre commencé une quinzaine d’années plus tard. Il y a un double objectif : retrouver les traces de son propre parcours en marchant dans ses souvenirs, et retrouver les lieux associés aux quatre morts de son entourage.
Ces évocations ponctuelles sont toujours l’occasion d’un retour de l’autrice sur ce qu’elle pense : ainsi, concernant Étaples et son incapacité à retrouver les camps temporaires où elle exerça, elle note « Même les croix usées par le temps (…) ont été remplacées après la guerre, dans notre frénésie mémorielle, par des édifices de pierre – un peu comme si l’on pouvait dédommager les morts par le souvenir pourvu qu’on ne regarde pas à la dépense. » page 400.
Elle ose aussi parler du traumatisme, près de 20 ans après. Elle ne supporte plus d’entendre le carillon de la porte, ayant tellement stressé au cours de la guerre : chaque sonnerie, chaque télégramme pouvant être annonciateur de la terrible nouvelle (page 147).
On perçoit également les changements profonds chez certains habitants à travers l’exemple de Vera Brittain. Elle envisage de vivre sans mari et sans enfant après le bouleversement qu’a été la guerre. Quand un homme la courtise en 1923, tout le questionnement sur ses choix individuels passe par les peurs de perdre sa carrière, de s’engager tant sa précédente expérience a été douloureuse. Elle exprime ses questionnements de manière toute aussi ouverte que dans le reste de l’ouvrage. Cependant, au-delà, le livre s’achève sur l’ouverture d’une nouvelle étape dans la vie de Vera Brittain par un événement qui vient fermer la parenthèse de la guerre et de ses suites : son mariage. Si la décision fut difficile à prendre, elle marque surtout une conclusion, page 715 :
« Il me restait encore la question finale et sensible de la loyauté envers les morts ; de savoir dans quelle mesure moi comme les autres femmes de ma génération – qui avions volontairement accepté d’autres relations émotionnelles – trahissions à nouveau la mémoire des hommes qui étaient autrefois, sans se plaindre, morts pour nous. En arpentant de long en large les allées étroites et désertes de Regent’s Park, ou en tournant en rond dans celles de la plaine de jeux de Paddington, je réfléchissais à la portée de ces dernières incertitudes. Malgré moi, et la douleur causée par leurs vies inassouvies que le temps ne pourrait effacer, un gouffre s’était creusé entre mon esprit et le leur ; le monde auquel à l’Armistice j’avais cru ne pas appartenir s’était rapproché et m’avait accaparée – ou était-ce plus tôt que mon regard sur mon destin s’était élargi à la dimension de ses besoins ?
Si les morts pouvaient revenir, me demandais-je, que me diraient-ils ? Roland – toi en France pendant la guerre mentionnas « un autre inconnu » dans tes écrits -, me trouverais-tu sans mémoire et infidèle parce que je l’épouserais ? Édouard, Victor, Geoffrey voudriez-vous que je sois réduite à penser à vous, à ces jours que nous partageâmes il y a si longtemps – ou souhaiteriez-vous que ma vie continuât ? Malgré la guerre qui a détruit tant d’espoir et de beauté, de promesses, la vie est encore là pour être vécue ; puisque je suis vivante, comment puis-je ignorer la nécessité de la vivre, d’affronter les problèmes qu’elle pose, de subir ses requêtes, ces incohérences ? »
Accessoirement, à l’occasion d’un séjour de trois mois avec son amie, elle offre un témoignage sur les sociétés dans les pays perdants d’Europe centrale. Elle revient alors sur un élément récurrent de son écriture : la disparition des meilleurs de la génération, pages 703-704 :
« Il semblait incertain, sans doute, que nous, la génération de la guerre, parviendrions à faire tout ce que nous avions autrefois envisagé pour vraiment reconstruire la civilisation. Je comprenais maintenant que les répercussions de la guerre dureraient plus longtemps que nous ; il était évident, en Europe centrale, que ses conséquences étaient plus profondément ancrées, et allaient plus loin que, avec notre manque d’expérience, nous n’avions pu l’imaginer à son issue. Dans tous les cas, les hommes qui auraient pu, en collaboration avec celles des femmes dont la santé n’avait pas trop pâti de l’effet des chocs et des angoisses, le plus contribuer à sa reconstruction, les meilleurs, les courageux avec l’imagination et l’esprit d’initiative, avaient eux-mêmes disparu pendant le Déluge, et leur absence impliquait maintenant des manques et des désastres dans tous les secteurs de la vie de la population. Peut-être, après-tout, que le mieux que nous puissions faire, nous qui étions restés, était de refuser d’oublier, et de transmettre à nos successeurs ce dont nous avions gardé mémoire en espérant qu’eux, quand leur tout viendrait, auraient plus de pouvoir pour changer l’état du monde (…). »
- En guise de conclusion
Jeune fille rebelle dans la société du début du 20e siècle, puis jeune femme amoureuse avant d’entrer dans le deuil et de se reconstruire, tel est le parcours proposé par le récit autobiographique de Vera Brittain. Elle nous offre un récit dense cherchant à immortaliser la mémoire de son frère et de son fiancé. Mais c’est aussi une plongée dans le travail des infirmières de 1915 à 1918, un aperçu du ressenti des civils au cours du conflit, Vera Brittain relayant ou évoquant de nombreux faits de guerre arrivés en Angleterre (attaque des ports, Zeppelins, bataille du Jutland, offensives sur le front, difficultés quotidiennes à partir de 1917), en plus de l’angoisse de l’absence et de l’incertitude du sort des hommes mobilisés. C’est aussi la société bouleversée après-guerre, les déceptions, la reconstruction individuelle.
D’une lecture aisée, dont le présent article rend difficilement la richesse, je recommande chaudement sa découverte pour qui ne connaîtrait pas : outre le fait de nous emmener dans un pays belligérant voisin, il permet de suivre le parcours d’une femme dans le conflit, dans son engagement puis dans le travail mémoriel entrepris pour cette génération morte. Une partie de l’ouvrage s’intéresse aussi à l’après-guerre d’une jeune femme qui se reconstruit émotionnellement, professionnellement, artistiquement et, en dernier, sentimentalement.
Il faut espérer que nous n’aurons pas à attendre à nouveau 90 ans pour bénéficier d’une traduction de la correspondance de guerre de Vera Brittain, Letters from a Lost Generation, ou la sélection de ses poèmes, Because you died.
Une mention particulière au travail de traduction remarquable de Josée Kamoun et de Guy Jamin.
- Trouver l’ouvrage :
Évidemment disponible chez Viviane Hamy Éditions, on en trouve depuis avril 2025 une version en deux tomes au Livre De Poche :
https://www.livredepoche.com/livre/memoires-de-jeunesse-tome-1-9782253248941
- Pour aller plus loin
Une très bonne mise en perspective de l’écriture du deuil :
- Voluntary Aid Detachment, pour en savoir plus : https://www.theworldwar.org/fr/exhibitions/second-battlefield-nurses-first-world-war ↩︎
- Pour en savoir plus sur ce poème évoquant un matin disparu qui finit par revenir au bout de 10 ans.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Enoch_Arden ↩︎ - Une grande partie de sa correspondance a été publiée et est désormais disponible en ligne. ↩︎