Remarque Erich Maria, À l’Ouest rien de nouveau. Paris, Le livre de Poche, 1986 (1928).
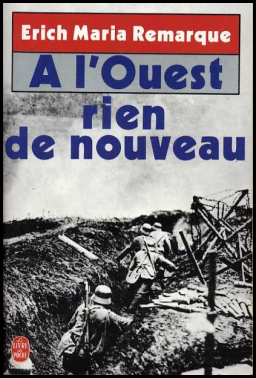
Est-il nécessaire de présenter cet ouvrage ? Il fait partie des cinq ouvrages classiques sur la Première Guerre mondiale. Mais par rapport aux autres livres connus du grand public que sont Le feu de Barbusse, Ceux de 14 de Genevoix, les Croix de bois de Dorgelès, celui-ci prend le point de vue allemand. Mais ce n’est pas le même point de vue qu’un autre grand classique allemand qu’est Orage d’acier de Jünger. Ici, il est ouvertement pacifiste et critique vis-à-vis de la société allemande qui conduisit au massacre de sa jeunesse.
J’ai utilisé cette ancienne version car c’est celle avec laquelle j’ai découvert ce texte et la Première Guerre mondiale. Mon nom y figure en lettres de collégien de 12 ou 13 ans…
Ce livre raconte le sort de jeunes hommes de 19 ans à peine, appartenant à la même classe. On suit tout particulièrement le narrateur, Paul Bäumer. Ils se sont tous engagés volontairement, le même jour, influencés par un professeur et poussés par la société. Ils reviennent tout au long de l’ouvrage sur leurs illusions perdues dès le premier obus, leur jeunesse gâchée, gaspillée, la déshumanisation. On y découvre leur quotidien fait d’adaptation, d’interrogations, l’importance de la camaraderie, mais aussi la carapace qu’ils se sont forgés, la perte des camarades, les réactions humaines dans les moments paroxystiques, les difficultés du quotidien (rats, ravitaillement, inconfort) et tout ce qui les rend supportables.
Ce livre donne un aperçu très complet de ce que fut la guerre. Même si on peut lui reprocher d’avoir pris la forme d’un roman pour le raconter, Remarque en a fait un récit très dense où il n’y a pas une page qui ne nous fasse pas découvrir un aspect du conflit, du plus quotidien au plus humain, du plus factuel au plus intime, jusqu’à des sommets d’horreur faisant penser à des eaux-fortes de Dix. Le fait que ce soit un roman n’enlève rien à la force évocatrice du récit. D’autant plus qu’il ne s’agit pas d’un texte écrit par un écrivain resté à l’arrière pendant la guerre : par ses détails, par son rendu du vécu des hommes, par ses effets du réel, il s’agit bien entendu d’un livre largement autobiographique, en tout cas largement nourri par la propre expérience de l’auteur, né en 1898 et donc entré très jeune dans le conflit.
- Au fil de l’ouvrage :
Le récit s’ouvre sur un groupe de soldats revenant de 15 jours de front, confrontés à un trop-plein de nourriture, la compagnie ayant perdu la moitié de son effectif le dernier jour sous le feu de l’artillerie anglaise. Puis les hommes se retrouvent sur des toilettes portatives et passent l’après-midi ainsi installés au soleil, à discuter et à jouer. Ce début peut surprendre car on est loin de l’image guerrière à laquelle on pourrait s’attendre. Elle est même choquante car ces soldats ne pensent qu’à manger et qu’à se divertir, revenant en fait aux fondamentaux de l’Homme.
Le début du récit construit par des va-et-vient entre le présent de ces hommes et des flash-back qui développent leur vie juste avant leur engagement, écoutant les remarques patriotiques de leur enseignant Kantorek, ou obéissant aveuglément au caporal instructeur Himmeltoss. Deux hommes dont la haine et le mépris sont immenses chez ces jeunes hommes. L’un leur a appris des savoirs réputés indispensables pour construire sa vie, sa carrière, l’autre l’obéissance aveugle d’un bon soldat. Deux savoirs antagonistes, le savoir scolaire devenant totalement inutile à la guerre ; le savoir militaire ne servant qu’à tuer et éventuellement à survivre mais faisant de ces jeunes des brutes. Deux savoirs qu’ils finissent par rejeter car leur ayant enlevé leur jeunesse.
L’un a utilisé « la phrase et l’habilité » ainsi que toute son autorité morale pour les pousser à s’engager ; l’autre a utilisé toute son autorité pour qu’ils combattent aveuglément, ce qui a brisé leur irritation et fait naître une indifférence, une obéissance ne reposant sur aucune réflexion. Un vrai « dressage », et l’expression est utilisée par l’auteur.
Ces flash-back sont aussi mis en parallèle avec l’agonie d’un de ces jeunes hommes, Kemmerlich, blessé, amputé. La visite de ses camarades permet à l’auteur de dire son dégoût pour le sacrifice de ces jeunes qui n’ont rien vécu et que la guerre a formés. Pour les plus âgés, il y a une famille, une situation à retrouver, mais pour les jeunes, rien.
L’auteur développe l’importance de l’expérience des vétérans, le rôle de la terre pour se protéger, le changement que provoque l’approche du front chez les hommes. Il utilise fréquemment des métaphores : « Le front est un tourbillon sinistre ». En ligne, les hommes sont devenus des « hommes-bêtes » (pages 57-58). Les hommes qui montent forment « Une colonne, mais pas des hommes ». La déshumanisation apparaît une première fois alors que jusqu’à présent, ces hommes étaient revenus à un état primaire.
Les hommes ne sont plus que des animaux. À la fin d’une corvée de barbelés, le groupe est pris sous un tir d’artillerie. Des chevaux sont touchés. Leurs cris, leurs souffrances font mal à voir, à entendre. Au final, le groupe a plus de peine pour les chevaux que pour les soldats blessés dont il n’est jamais question. Peu après, ils sont pris sous un barrage d’artillerie et doivent se réfugier dans un cimetière et se cacher dans des tombes crevées par les obus, à côté des morts. Comme on achevait les chevaux blessés, le groupe est prêt à achever un jeune blessé, à peine plus jeune qu’eux ; ne pouvant le faire, un homme conclut : « Les pauvres gosses innocents !… ». Ils n’ont pourtant que 19 ans, la guerre fait vieillir.
Au cours d’un repos interrompu par l’arrivée au front d’Himmeltoss qui a quitté la caserne, ils s’interrogent sur ce qu’ils feront une fois la paix revenue. C’est l’occasion, une fois de plus, de vilipender l’enseignement reçu qui paraît si dérisoire et inutile dans la situation où ils sont. Et puis, chacun a ses rêves, ses envies, ses espoirs, très vite ternis par des remarques comme « Il faut d’abord rentrer, et on verra bien » page 88 et par une conclusion : la guerre a tout bouleversé. Comment se réinsérer dans cette société, y trouver sa place et une motivation après toutes les horreurs traversées ? « C’est le sort commun de notre génération » et « la guerre a fait de nous des propres à rien » page 89 achèvent de montrer que la guerre a broyé leur jeunesse, leurs espoirs.
Le chapitre VI nous emmène avec le groupe en première ligne alors que les Français préparent une offensive. Ironiquement, les hommes passent à côté de cercueils neufs… Le groupe va subir de longues journées de bombardement puis de combat avant d’être enfin relevé ;
Comme on le lit aussi régulièrement du côté français, l’artillerie allemande tire sur ses propres troupes à cause de l’usure des tubes.
Cette fois-ci, « le front est une cage », page 101, soumis au hasard qui empêche d’être maître de son destin sous un bombardement. Il faut se battre aussi contre les rats. L’auteur évoque les fameuses baïonnettes-scies si craintes et haïes par les ennemis. Il explique que la pelle est plus efficace que la baïonnette en cas de corps à corps. La nuit est passée masque à gaz sur le visage, dans la crainte d’un assaut anglais qui ne vient pas et qui réveille le spectre de l’assaut contre la Somme et de sa très longue préparation d’artillerie encore en mémoire chez certains vétérans.
Le bombardement dure trois jours. Certaines jeunes recrues craquent, perdent la raison ; des abris s’effondrent, celui occupé par le héros est lui-même touché, son entrée bouchée temporairement. De longues pages sont consacrées à ce que subissent les hommes, physiquement comme psychologiquement. Il évoque aussi le bruit : « Peu à peu nous devenons sourds. Personne ne parle plus ; d’ailleurs on ne pourrait pas se comprendre ». Le tir s’arrête, les Français attaquent, le corps à corps s’engage, les Allemands reculent puis contre-attaquent et vont jusqu’à repousser les assaillants dans leur tranchée de départ qu’ils occupent brièvement. On observe la mort reçue, la mort donnée, la déshumanisation tout au long de ces longues pages consacrées à ces combats d’une journée rare, paroxystique. Après quoi, les hommes s’effondrent. Le silence ne revient pas pour autant car c’est quelque chose qui n’existe pas : « Au front il n’y a pas de silence (…). Même dans les dépôts et dans les endroits où nous allons au repos, le grondement et le vacarme assourdis du feu restent toujours présents à nos oreilles (…). Mais, tous ces jours-ci, ç’a été insupportable. »
La fin de ce chapitre VI est consacré à une réflexion sur la manière que les hommes ont de digérer tout ce qu’ils ont vécu. Il évoque un paysage qui est en fait une métaphore de leur jeunesse. Les souvenirs de ce paysage « éveillent en nous moins de désirs que de la tristesse, une mélancolie immense et éperdue » page 123. La guerre a détruit ces moments heureux, ces paysages, leur jeunesse. Il utilise une image très parlante : ce souvenir de paysage, c’est comme la photographie d’un camarade mort : « ce sont ses traits, c’est son visage et les jours que nous avons passés avec lui qui prennent dans notre esprit une vie trompeuse, mais ce n’est pas lui ».
« Nous ne sommes plus insouciants, nous sommes d’une indifférence terrible » page 124.
Les jours qui suivent alternent bombardements, attaques, contre-attaques, appels des blessés restés, agonisant parfois pendant plusieurs jours, dans le no man’s land. Ce sont encore des pages dures qui sont entrecoupées de moments plus légers comme ceux sur la recherche des ceintures de cuivre des obus et aux parachutes de soie des fusées éclairantes françaises (page 128-129). Mais on revient encore vers les morts « Nous déposons provisoirement les morts dans un grand entonnoir. Il y en a, jusqu’à présent, trois couches superposées » page 129.
Nouvel intermède dans l’horreur du combat, un passage concernant l’utilisation des jeunes recrues inexpérimentées, encore enfants, destinées à fournir l’essentiel des pertes. « Ils portent des vestes, des pantalons gris et des bottes de soldats, mais, pour la plupart, l’uniforme est trop ample, il flotte autour de leurs membres, leurs épaules sont trop étroites ; leurs corps sont trop menus ; on n’a pas eu d’uniformes à la mesure de ces enfants », page 132.
Ces jeunes écoutent les conseils mais la peur, le stress font qu’ils n’appliquent pas les conseils. Ils tombent souvent avant d’avoir eu le temps de s’aguerrir un minimum. Et puis il y a les mots : « Feu roulant, tir de barrage, rideau de feu, mines, gaz, tanks, mitrailleuses, grenades, ce sont là des mots, des mots, mais ils renferment toute l’horreur du monde », page 134. L’horreur continue jusqu’à la relève, une horreur qui atteint son paroxysme pour le lecteur quand Remarque décrit le retour de blessés vers l’arrière, des mourants qui veulent vivre, des blessures atroces mais des hommes qui s’accrochent désespérément à la vie, seuls.
Tout cela pourquoi ? « Le petit morceau de terre déchirée où nous sommes a été conservé (…). Mais pour chaque mètre, il y a un mort ». Ne restent que 32 hommes sur les 150 montés en ligne. « On peut l’appeler longtemps [la 2e compagnie] : on n’entend rien dans les infirmeries, ni dans les entonnoirs », page 137.
Le chapitre VII est consacré au repos après les combats ainsi qu’à la confrontation à la vie de l’arrière pendant une permission.
Au repos, les hommes mangent et se reposent : « Les horreurs sont supportables tant qu’on se contente de baisser la tête, mais elles tuent, quand on y réfléchit », page 140. À l’arrière, les hommes veulent vivre. Ils ne pensent pas au reste : « nous ne pouvons pas nous alourdir de sentiments qui pensent être décoratifs en temps de paix, mais qui, ici, sont absolument faux »., « Cent vingt hommes sont couchés quelque part (…) ; c’est une chose maudite, mais en quoi cela nous touche-t-il maintenant ? Nous vivons. » Vivre, c’est dormir, boire, manger. « La vie est courte ». Ils rient du front, de la mort. On retrouve ces bravades dans de nombreux témoignages, mais là, elles sont exposées de manière très crues : « Lorsque quelqu’un meurt, nous disons qu’il a fermé son cul et c’est ainsi que nous parlons de tout. Cela nous empêche de devenir fous », page 141. Il fait à cette occasion la distinction entre la peur et la peur de mourir. Cette dernière est physique. Il s’attaque alors aux journaux. Il qualifie ce qu’ils écrivent de « stupidité ».
Cette attitude ne veut pas dire qu’il y a un détachement, qu’ils ne sont pas touchés par tout ce qu’ils vivent. Ils le sont et après-guerre « Les jours, les semaines, les années de front ressusciteront à leur heure et nos camarades morts reviendront alors et marcheront avec nous. », page 142.
Au repos, il y a le flirt avec des Françaises. Mais cela réveille en lui non de la passion mais des images : les bordels à militaires, les horreurs des combats. La guerre est partout, elle pollue sa jeunesse même quand, un instant, on pourrait l’oublier.
Il apprend qu’il a droit non seulement à une permission, mais qu’elle va se poursuivre loin du front avec quatre semaines dans un camp.
Cette permission se découpe en plusieurs parties. D’abord son arrivée, avec les souvenirs qui reviennent violemment en passant dans une rue, devant une boutique, devant un lieu où il y a si peu il s’amusait avec ses amis souvent déjà disparus. L’arrivée dans la maison, les mots de sa sœur, la maladie de sa mère, les privations qui touchent la population. Ensuite, il y a la période où les questions des amis, et même du père sont le seul sujet de discussion. Alors, il ment, ce qu’il a vécu étant indicible et aucun mot ne permettant de le retranscrire. Il ment à sa mère pour qu’elle ne s’inquiète pas. C’est pendant cette longue période qu’il mène une réelle introspection : il a changé et pas seulement physiquement. Ses livres d’écoliers n’ont plus de sens, les livres qu’il aimait tant non plus. Ce sont aussi les mesquineries d’un officier puis le passage pour voir un ami à la caserne où il retrouve comme recrue son ancien professeur Kantorek. Son ancien élève devenu officier prend plaisir à l’humilier comme il le faisait lui-même quelques années auparavant. Non sans lui rappeler que de jeunes hommes sont morts avant leur heure à cause de ses discours.
Et puis il faut déjà partir, faire ses adieux à sa mère malade, à sa sœur.
Le chapitre VIII est court : il relate son séjour au camp des Landes. Plus que ses entraînements quotidiens, il évoque la beauté des paysages où le marron n’est pas celui de la terre et le rouge n’est celui du sang. Il parle de la proximité du camp de prisonniers russes. Ils ont faim, ils meurent de la diphtérie. Se pose alors la question du « pourquoi tout cela » ? Tous obéissent aux ordres et sont poussés à se battre les uns contre les autres. Et s’il n’y avait pas ces ordres ? Il préfère ne pas penser à la réponse tant elle rend la situation actuelle absurde.
Il revoit une dernière fois sa famille : le père fait tout ce qu’il peut pour que sa mère puisse être opérée de son cancer. La situation s’inverse : c’est Paul qui raconte des histoires militaires pour égayer les pensées de sa famille, lui qui auparavant ne voulait pas parler quand on l’interrogeait.
Le chapitre IX est court aussi, mais c’est probablement le plus connu. C’est celui de la reconnaissance dans le no man’s land. Paul, de retour de permission, est volontaire. Il est pris de panique, seul dans le noir. Quand il se reprend enfin, il se perd et doit faire le mort pendant une attaque surprise française de nuit. Ils sont repoussés mais en revenant un Français tombe sur Paul qui le poignarde à trois reprises. Commencent de longues heures d’angoisse, bloqué dans le trou d’obus à côté du soldat agonisant. Paul a tout le temps nécessaire pour penser et cela l’entraîne dans une sorte de folie. Il a tué de ses mains, l’homme finissant par mourir après de longues heures d’agonie. L’homme a un nom, il a une famille ; c’est un homme comme lui. Cette prise de conscience s’ajoute à une discussion qu’il a eue avec ses camarades peu avant sur le pourquoi de cette guerre. « C’est bizarre quand on y réfléchit (…). Nous sommes pourtant ici pour défendre note patrie. Mais les français, eux aussi, sont là pour défendre la leur. Qui donc a raison ? » avait lancé un homme. C’est surtout l’occasion pour Remarque de développer le thème de l’absurdité de la guerre et donc son pacifisme (thème déjà évoqué dans le chapitre précédent à l’occasion de sa rencontre avec les Russes prisonniers).
Le chapitre X décrit à la fois les circonstances des blessures de Paul et d’Albert et leurs parcours médicaux. Si Paul s’en sort bien et peut retourner au front après une permission, son ami est amputé. « C’est ici qu’on voit sérieusement tous les endroits où un homme peut être blessé », page 258 : Remarque profite de ce chapitre qui éloigne son héros du front pour décrire la vie et les questionnements des blessés, la visite des proches, le manque d’intimité, les soins, les souffrances.
« Il y a des centaines de mille en Allemagne, des centaines de mille en France, des centaines de mille en Russie ? Puisque pareille chose est possible, combien tout ce qu’on a jamais écrit, fait ou pensé est vain ! Tout n’est forcément que mensonge ou insignifiance, si la culture de milliers d’années n’a même pas pu empêcher que ces flots de sang soient versés et qu’il existe, par centaines de mille, de telles geôles de torture. Seul l’hôpital montre bien ce qu’est la guerre », page 259.
Le récit se fait moins continu. L’avant-dernier chapitre, le XI, raconte le dernier retour de Paul au régiment, en 1918. Pour lui, l’ « activité indicible », c’est la vie ! Dans de telles perspectives (la guerre est perdue, les soldats l’ont compris), que reste-t-il ? « Nous sommes de petites flammes protégées tant bien que mal par de faibles parois contre la tempête de l’anéantissement et de la folie ; nous vacillons et, parfois, nous sombrons presque ». Pour lui, ce qui leur permet de tenir : c’est la camaraderie.
Il déplore l’enrichissement des industriels, mais les combattants ont faim, sont malades : « On devrait montrer aux gens de l’arrière ces figures terreuses, jaunes, misérables et résignées, ces corps courbés en deux, dont la colique épuise douloureusement le sang (…) », pages 273-274.
Il dit toute l’importance qu’ont pris les chars dans cette guerre avant, une nouvelle fois, de dire tout ce qui se cache derrière certains mots (page 276) :
« Obus, vapeurs de gaz et flottilles de tanks : choses qui vous étouffent, vous brûlent et vous tuent.
Dysenterie, grippe, typhus : choses qui vous étouffent, vous brûlent et vous tuent. »
Kat est blessé. Paul le transporte vers un poste de secours mais son ami est mort en arrivant, tué par un éclat d’obus au cours du trajet. Paul se retrouve cette fois-ci seul, tous ses autres camarades ayant été tués ou blessés au cours des derniers mois de la guerre. La guerre, la mort, tout est devenu d’une étonnante normalité qui fait écrire à Remarque : « Tout est comme d’habitude ».
Il ne reste que le chapitre XII, long de trois pages. Paul s’interroge sur le destin de sa génération. Il en a une vision désespérée, il est le dernier des sept amis encore présent. Il espère que tout ce qu’il a vécu n’a pas définitivement effacé ses rêves, ses désirs. On apprend alors qu’il meurt en octobre 1918. ce n’est qu’à ce moment que le titre prend tout son sens : un homme est mort, mais ce n’est pas important. Et les mots cachent l’horreur de la situation quotidienne pendant cette guerre.
- Une galerie de personnage :
En gras, le groupe des sept amis au centre du récit.
| BÄUMER Paul | 19 ans, narrateur. Élève de Kantorek. Affecté à la 6e escouade du caporal Himmeltoss. Soldat à la 2e compagnie. | Blessé en 1916. Tué en octobre 1918 (chapitre XII). |
| KEMMERICH Franz | 19 ans. Élève de Kantorek. Affecté à la 6e escouade du caporal Himmeltoss. Soldat à la 2e compagnie. | Blessé, amputé d’une jambe, mort à l’ambulance. |
| KROPP Albert | 19 ans, soldat de 1ère classe. Élève de Kantorek. Affecté à la 6e escouade du caporal Himmeltoss. Soldat à la 2e compagnie. | Blessé et amputé. |
| MÜLLER | 19 ans. Élève de Kantorek Affecté à la 6e escouade du caporal Himmeltoss. Soldat à la 2e compagnie. | Mort des suites d’une blessure par fusée d’obus dans le ventre (chapitre XI). |
| TJADEN | 19 ans, serrurier. Élève de Kantorek. Affecté à la 6e escouade du caporal Himmeltoss. Soldat à la 2e compagnie. | Sort inconnu. Mais probablement évacué car Paul dit p. 285 « Je suis le dernier des sept sortis de notre classe ». |
| LEER | 19 ans, barbu. | Mort des suites d’une blessure par éclat d’obus, hanche emportée (chapitre XI). |
| WESTHUS Haie | 19 ans, ouvrier tourbier. Élève de Kantorek. Soldat à la 2e compagnie. | Mort des suites de blessure par éclat d’obus, dos arraché (Chapitre VI). |
| DETERING | Paysan, marié. | Déserte, passe devant un conseil de guerre. Sort inconnu. |
| KATCZINZKY Stanislas dit Kat. | 40 ans, « dur, rusé, roublard ». | Tué en 1918 par éclat d’obus à la tête après blessure par balle à la jambe (chapitre XI). |
| BEHM Joseph | 19 ans, peu décidé à s’engager. Élève de Kantorek. Soldat à la 2e compagnie. | 1er tué du groupe d’élèves après avoir été aveuglé lors d’un assaut. |
| WOLF | 19 ans. Élève de Kantorek. Soldat à la 2e compagnie. | Mort d’une pneumonie à la caserne. |
| TIEDJEN | Mort à l’hôpital en réclamant sa mère. | |
| Sont aussi mentionnées les morts de Hans Kramer, Martens, Meyer, Marx, Beyer, Hämmerling. | ||
- En guise de conclusion :
Que les mots de Remarque sont amers, empreints de désespoir, désabusés, d’une profonde tristesse. La guerre lui a très vite pris son innocence, ses espoirs, la joie et la curiosité caractéristiques de sa jeunesse. La guerre lui a pris sa vie : s’il ne l’a pas laissée au sens propre du terme, son expérience a construit ce qu’il est après, effaçant tout ce qui était « lui » (le « Je » de la fin du livre) et ce d’autant plus que c’est sa seule expérience et qu’elle est si marquante qu’aucune autre ne pourra l’effacer.
Dans un premier temps, on lit cet ouvrage et on est mis face à la guerre dans toute son horreur : l’auteur nous la montre, insistant ensuite sur le fait que chaque mot que nous lisons renferme une horreur inimaginable. Dans un second temps, le récit se fait plus militant en montrant ses héros se poser des questions qui interrogent aussi le lecteur. Questions qui vont toutes dans le sens d’une vision pacifiste des choses. En lisant Remarque, on ne peut voir la guerre que comme quelque chose de sale, d’ignoble et d’évidemment indicible. Les hommes font leur devoir, mais à aucun moment ce ne sont des héros. Le mot « croix de fer » n’est mentionné qu’une fois dans le texte, et par un civil ignorant tout de la réalité du conflit.
C’est un cri que l’on retrouve chez de nombreux auteurs, poussé plus ou moins fort (on est loin de l’intensité de l’implacable réquisitoire de Guéhenno dans « La Jeunesse morte »). Par rapport à d’autres auteurs, Remarque est plus cru dans sa description du quotidien des soldats, son récit est beaucoup plus sombre. Il n’en est pas moins remarquable et incontournable.
- Pour aller plus loin :
Proposition de classiques à découvrir sur le conflit.
- Autre ouvrage de l’auteur :
