FAUCONNIER Henri, Lettres à Madeleine, 1914-1919, Paris, Éditions Stock, 1998, 372 p.
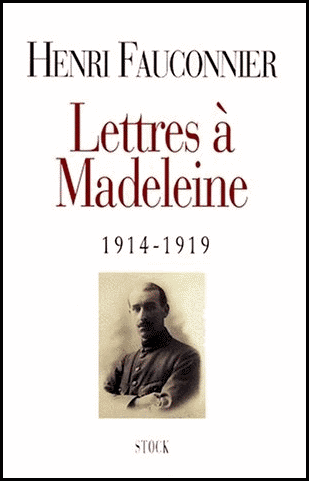
Déjà 1988 avait fait l’objet d’un grand nombre de publications à l’occasion du 80e anniversaire de l’armistice. Toutefois, il ne s’agissait pas encore de témoignages ressortis des archives familiales mais souvent de textes de plumes connues. Ici, la correspondance d’Henri Fauconnier, lauréat du Prix Goncourt en 1930, est publiée. Le titre est similaire et ne doit pas être confondu avec les Lettres à Madeleine de Guillaume Apollinaire.
On regrettera une mise en perspective quasi-inexistante de ces lettres : sont-elles complètes ? S’agit-il d’une sélection ? Rien ne vient le préciser. Surtout, on ne dispose que de trop peu d’éléments de contextualisation sur la vie de son auteur. Heureusement, les notes de bas de page et surtout le prologue compensent en partie ces lacunes.
- Entrée en guerre
Outre le fait qu’il s’agisse d’un écrivain, cet homme déjà âgé de 35 ans en 1914 vit et travaille en Malaisie. Cela donne un cachet particulier à son retour vers la métropole en bateau, dans l’océan Indien puis la mer Rouge. Il n’arrive qu’en septembre 1914 et il intègre le dépôt du 93e RIT de Périgueux.
Il note « surtout, je voudrais être arrivé, et quitter cette paix trop délicieuse de la traversée pour les fatigues et les fureurs de la bataille ». Cette image, même s’il sait qu’il va vers « l’inconnu (…) plein d’horreurs » ne va pas durer longtemps dans ses mots. Dès le 22 septembre, il décrit sa première journée au dépôt, avec « des vieux papas des classes 93 », ce qu’il mange et où il dort. Un mot ressort: « morne ». La description de sa première semaine faite d’exercices, de marches et de manœuvres, est loin de ce qu’il imaginait. Il note déjà le 29 « J’ai perdu quelques illusions. J’arrivais plein d’ardeur et prêt au dévouement (…) Et je tombe dans une vie de caserne qui a conservé toutes les mesquineries du temps de paix ». « Pour moi, ça m’ennuie, et je grogne. Mais je ne grogne que dans mes lettres, car je suis un excellent soldat. L’habitude de commander m’a appris l’utilité de l’obéissance immédiate » note-t-il le 2 octobre.
Il est volontaire pour une section de mitrailleuses. Après un faux départ, il est finalement versé au 310e RI en novembre 1914. Il s’est évidemment fait photographier à cette occasion, mais le cliché n’est pas publié. C’est peut-être l’un de ceux visibles sur internet :

Son uniforme du 50e RI n’est pas illogique. Même si sa seule affectation au 50e RI date de son court service actif en 1902, il est équipé d’une capote usagée de ce régiment car il gère également le 93e RIT auquel il appartient en 1914. Son couvre-képi indique en tout cas à n’en pas douter que le cliché a bien été pris en 1914,
Il arrive fin novembre dans la zone des armées. Son écriture se fait plus précise. Il narre par le détail son trajet ainsi que l’organisation de la vie au front. Il ajoute le 1er décembre ses impressions sur la vie en première ligne. Ses mots sont d’une rare précision. Un extrait très parlant est publié pages 40-41, en date du 1er décembre 1914. La finesse de l’écriture est bien visible :
« Nous sommes en première ligne, il n’y a entre nous et les Boches que le « Poste des Écoutes », qu’on occupe la nuit, et quelques centaines de mètres de terrains vagues, anciens champs de blé où se plantent maintenant des pieux pointus intercalés de semis en tessons. Mais ça et là, sur cette plaine, on aperçoit encore des paquets grisâtres, cadavres qui n’ont pu être enterrés ; car on en est arrivé, dans cette guerre hideuse, à ne plus demander ni accorder la trêve locale pour secourir les blessés et reconnaître les morts. Et combien de ceux-ci ne sont pas morts que de leurs blessures ? Voici trois mois que les deux camps se regardent ainsi sans changer de place, comme hypnotisés par ce désert de mort où, la nuit, on croit entendre hurler des spectres. Et tous ces coups de fusils tirés au hasard dans le noir, est-ce autre chose que la peur qui les fait partir ? On est de garde au Poste des Écoutes du crépuscule à minuit, ou de minuit à l’aube – sept heures de faction chaque nuit, sans abri, à portée de voix de l’ennemi pendant tout le temps qu’on passe en 1e ligne. La faction du soir est moins fatigante mais vous transit pour le reste de la nuit. Celle du matin ne vous appelle souvent qu’à peine endormi, vous traîne avec elle comme un fleuve lent et glacé et se perd insensiblement dans un sinistre demi-jour. On s’accoude, on s’adosse aux parois suintantes de la tranchée, pour que la tête ne dépasse le bord que le temps de sonder d’un regard rapide l’espace d’où l’ennemi pourrait surgir. On en profite pour tirailler au ras du sol vers des ombres suspectes, ou, si l’ennemi tire lui-même, dans la direction des lueurs que font ses fusils. Et parfois, engourdi de fatigue et de froid, on ne brûle des cartouches que pour rester éveillé, ou se chauffer les doigts au canon de son arme. De temps en temps, il passe un sous-officier qui vous regarde sous le nez sans rien dire. Puis un ordre circule : « Ne tirez plus, il y a une patrouille qui part en avant » – ordre qu’on va transmettre à la sentinelle voisine. S’il fait du brouillard, on peut avoir à sortir de la tranchée pour placer en avant de nos lignes des tétraèdres de bois garnis de fil de fer barbelé ; on travaille vite en se faisant petit et quand une balle siffle un peu trop près de l’oreille, on a le même petit frisson que si une guêpe venait la frôler.
Mais tout à coup, la plaine s’illumine tragiquement et l’on s’abat comme des chiffons qui tombent. Là-haut, au-dessus de nos têtes, luit une lumière blanche de magnésium lancée par une fusée et qu’un parachute balance dans le vent. Et nous restons là, serrés contre la terre protectrice, à regarder pâlir lentement cet astre hostile. La fusillade a redoublé, et les balles claquent sur le sol comme des coups de fouet. Derrière nous, en 1e ligne, les veilleurs se sont émus et, croyant à une attaque, appellent aux armes les hommes cachés dans les abris. Tout à coup, « Prrrrac »… Ce sont nos mitrailleuses qui scandent le tumulte du bruit mécanique de leur crécelle : mais c’est une fausse alerte due à l’énervement des sentinelles fatiguées. Le silence retombe. Nous regagnons en rampant notre tranchée et, dans le jour qui blanchit autour de nous, vient la détente des nerfs ; nos yeux se ferment et, le front appuyé au bord froid du créneau, nous laissons notre conscience flotter entre la vie et le rêve, descendre lentement dans un abîme blanc comme l’oubli. Puis des frôlements nous tirent de notre torpeur. Une longue file d’hommes enveloppés de loques grises passent dans le boyau ; un soleil tiède va sortir des brumes que chasse le petit vent aigre du matin. »
Dans ses autres courriers, il est très factuel : les colis, le fait qu’il est le moulin de café de l’escouade, la tentative de tutoiement de la femme qu’il aime, tout se mélange ; son 24 décembre dans une grange crasseuse, la population peu accueillante du village et qui vend à prix d’or le nécessaire, la messe.
Par chance, il veut donner à sa lectrice « l’atmosphère des choses », toujours page 46. Ses premiers écrits sont tout aussi documentaires que les derniers de 1914. Il parle du temps, « j’ai été trempé copieusement hier, je ne me déssèche (sic) que lentement (…) » écrit-il le 10 janvier. Il décrit plusieurs fois le cantonnement mais aussi un nouvel abri en tôle de métro. Il évoque aussi des moyens d’avoir des informations sans toutefois parler des bruits. Le 1er février, il écrit sur une carte allemande.
Le 4 février, il envoie un morceau de sa capote et écrit « C’est pris dans la doublure, et c’est encore couleur de neuf, mais l’extérieur a tant traîné dans la marne et la vase, a été si bien éclaboussé de soupe et de vinasse, taché de graisse d’armes, tant de bougies ont pleuré dessus, qu’il est un peu de toutes les couleurs maintenant (…). Petit à petit je me rapproche du gris sale des Boches ».
Les événements quotidiens sont narrés en détails : un bombardement, un déplacement.
Le 1er mars 1915, il devient mitrailleur, il quitte la compagnie du lieutenant Macquart et passe sous les ordres de l’adjudant Vaton.
Déjà en mars, suite à un bombardement, « tout le monde est sorti des tranchées et on a ramassé de quoi faire beaucoup de bagues », page 67. À plusieurs occasions il mentionne les usages de ces éclats : « Les artilleurs jouaient au bouchon avec des culots d’obus », page 72. « Je suis content que la bague de guerre vous ait fait plaisir. J’en ai une pareille », page 91.
Mais la guerre et ses risques restent omniprésents. Il précise à qui écrire en cas d’absence de nouvelles, « en cas d’interruption vraiment anormale dans mes lettres », page 69. « Quant au danger, il est partout sur le front c’est une loterie ». Il ne manque pas de décrire son état d’esprit : le 20 mars « abruti au point que depuis une heure je ne peux plus rien dire que « Oh la la, Oh la la » et je ne sais même pas quels sentiments traduisent ces oh la la. C’est comme une crise de nerfs du cerveau. Ma tête est une marmite et mes pensées s’éparpillent comme des shrapnells. Je voudrais charger à la baïonnette ou prendre une cuite ».
Le lendemain, il précise « Voici des mois que je n’ai pas vécu, ou comme un animal qui souffre confusément, qui lutte pour garder sa place dans un monde qu’il ne comprend pas. Bête féroce qui veut tuer, bête domestique qui peut être sera sacrifiée demain(…). » Les effets de la guerre sur son corps ne sont pas oubliés : « À l’occasion, il décrit le 13 avril les effets de la guerre sur son corps, le vieillissement. »
- Ménager sa lectrice
Henri Fauconnier adresse à plusieurs reprises des notes à Madeleine plusieurs mois après leur rédaction. Il s’en explique le 8 mars « J’envoie des vieilles notes de décembre, que je n’avais pas envoyées ne voulant pas trop impressionner dès le début », page 68. Il évoque la difficulté de tout écrire : 5 avril « Il y a tous les jours des bombardements, fusillades, incidents qui pourraient faire le sujet d’une lettre. Je ne pense même plus à en parler. Quant à les noter sèchement, avec le jour et l’heure, cela ne serait qu’une nomenclature. J’aime mieux essayer de vous faire voir, de temps en temps, quelques épisodes au hasard. »
On perçoit le bonheur qu’il a à lire les lettres de sa bien-aimée malgré le grand écart que cela représente pour le mobilisé, « vos lettres me tirent un instant de mon cauchemar », page 74.
La censure est une réalité, mais dans le sens civil-armée : « votre dernière lettre m’est arrivée censurée et amputée de la moitié d’une page ». À plusieurs autres occasions il évoque la censure pour justifier son silence sur certains faits. Mais il ajoute que le manque de temps explique aussi ses silences page 171.
- Entendre la guerre
Henri Fauconnier évoque à de multiples reprises les sons de la guerre et les rumeurs qui parcourent les rangs. Dès la page 46, après une allusion aux vols d’horloges par les Allemands, il écrit : « On a appris à ne croire qu’à moitié à ce qui se raconte ». plus tard, il note, page 148, « À midi « on dit » que les zouaves ont repris les positions perdues et fauché onze attaques… qu’il y a devant eux des monceaux de cadavres… ».
Le 7 avril, il décrit le bombardement « Il retombe des éclats jusque derrière nous, et j’en ramasse un qui est arrivé dans la tranchée en bourdonnant comme une des grosses cordes d’un piano qu’on ferait vibrer », page 77. Page 78, à l’occasion d’une alerte de nuit il écrit « La fusillade est si drue que le bruit des artilleries s’entend à peine. Et partout, c’est un mugissement, une vibration sourde qui vous prend aux entrailles ». Le bruit de l’artillerie fait aussi l’objet de cette description page 106 : « Il y a juste derrière nous, dans un champ, une batterie de 75 (…). Et puis tout à coup c’est comme une course effrénée de chats qui miaulent dans les airs. Dix, vingt chats enragés dans une brouette. (…) Puis un taratata taratata et un autre long miaou plaintif, les griffes qui s’éparpillent ».
- Évolution de sa vision de la guerre
Le point de vue d’Henri Fauconnier sur la guerre change à mesure que la guerre s’éternise. Alors qu’il appelait de ses vœux son envoi au front en 1914, dès 1915, il montre qu’il ne pense plus ainsi, son propos se fait même parfois critique vis-à-vis des choix réalisés.
Le 7 juin 1915, il prend des notes sur la bataille d’Hébuterne. Il est en réserve jusqu’au 10 juin. « Nous avons déjà vu souvent la mort planer sur nous, et parfois notre insouciance s’en allant, et les visages devenaient grave. Puis la conversation reprenait, mais les premiers morts avaient une résonance étrange, comme une voix parlant haut dans un caveau », page 85.
Le 13 juin, il raconte ce qu’il voit, entend, pendant une attaque. « Causé avec un blessé légèrement atteint, mais à moitié abruti, comme tous ceux qui reviennent des tranchées ». « C’est une guerre d’apaches (…). Je n’ai jamais été aussi content d’être mitrailleur que depuis que je vois de quel genre de travail cela m’exempte ». Bilan le 16 juin « Il est amer de voir souffrir et mourir ces pauvres gens pour un résultat dont la portée nous échappe. Mais ils comptent pour si peu ! Ce sont des matricules qu’on biffe d’une liste ».
Il ne supporte plus les musiques militaires pendant que des hommes souffrent et meurent dans les infirmeries. « Je voudrais être loin de toute cette barbarie, dans de beaux pays sauvages », page 88.
L’importance de l’arrière est évoquée dans plusieurs courriers. « Je pense à vous souvent, avec une peine mélangée d’une grande douceur. Pardonnez-moi cette douceur qui est de l’égoïsme, mais dans ces jours que je traverse j’ai besoin de cela. Je vois ici tant de choses terribles et tant de souffrances que je suis obligé de réagir pour ne pas avoir envie de mourir ainsi. » « S’il faut que je continue à vouloir vivre, il faut me savoir aimé ».
Le 18 juin, il reprend les mots de sa Madeleine qui veut devenir infirmière et qui a dû assister à des opérations lourdes. Il conclut « j’ai fait un rêve involontaire, celui d’une blessure grave qui m’emporte d’ici, et je vous vois vous pencher sur mon lit d’hôpital… c’est mon rêve de bonheur, je n’ose espérer mieux », page 190 (18 juin). Pour la première fois, le 5 juillet, il parle de l’espoir d’une permission. « Dans la vie militaire rien n’est certain que ce qui a déjà été réalisé ».
Le 31 juillet, il raconte son état d’énervement à l’idée de partir en permission : « Avec les soupirs des embusqués et des spectateurs, on ferait un gaz asphyxiant qui balayerait l’Allemagne », page 95. Après sa permission, il rédige de longs paragraphes. Il fait d’abord un bilan de ces quelques jours qui lui paraissent un paradis en comparaison avec le monde qu’il retrouve. « J’ai retrouvé ici l’été maussade du Nord. Un vent froid souffle tout le jour, comme si l’hiver s’impatientait. La pluie est venue, par rafales brusques, fouetter la porte de la grange, et le fumier qui est tout mon horizon fait déborder une eau noire qui suinte sur toute la cour », page 96.
Ce n’est que le 21 octobre 1915 qu’il fait parvenir à son amie son compte-rendu des combats de Champagne dont-il ne parle à aucun moment dans ses courriers précédents. Il rédige son texte sous la forme d’anecdotes. Le 27 septembre, alors qu’il est agent de liaison et qu’il s’arrête pour parler à son lieutenant, un obus explose exactement à l’emplacement où il aurait dû être. Le 29, il évoque une fois encore les rumeurs et donne un exemple parlant : « (…) voici un motocycliste (…) jetant des nouvelles qu’on n’entend pas. Il s’agit pourtant de prisonniers boches. On se consulte. Certains ont compris 5000, d’autres 15000, 25000. Et Combes, le muletier, 500 000 ! ». Il précise au milieu de sa description « Naturellement le terrain est parsemé de cadavres ». Arrivant en première ligne, il note « On craint de s’étendre à côté d’un cadavre », page 114. Sous le bombardement, il est « d’une passivité absolue. Mes nerfs sont absolument calmes. Je ne pense plus ».
Le 7 octobre, il n’écrit que quelques mots, rien de construit. Le 25, il évoque la disparition d’un ami au cours de combats, des hypothèses possibles concernant cette disparition. Au cœur de lettres d’un amoureux à sa promise, il écrit « J’ai été si près de la mort (et je suis resté si longtemps sous son regard) que je puis maintenant dire avec certitude qu’elle ne me fait pas peur. J’ai connu les heures solennelles où l’on est absolument sincère avec soi-même. J’en remercie mon destin ».
Si une partie de la correspondance de 1916 est très sentimentale, une autre est tournée vers la réflexion sur la situation. Par exemple, en ce qui concerne les permissions, « On promet, on annonce, on suspend, donne et on retire, et quand enfin nous tenons notre joie, elle est entourée de tant de restrictions, de règlements et de petites vexations que nous avons envie de dire moutarde », page 142. Il utilise pour la première fois le mot « cafard » le 13 février 1916.
« Je n’engraisse pas, je m’empâte. Mes joues pendent, et ma peau colle à mes os, je vieillis de corps et d’esprit. Si la guerre dure encore un an, elle me rendra à vous morose et pessimiste ».
Évoquant Verdun le 22 février 1916, il écrit « Je puis le dire, car cette lettre ne partira que quand tout sera fini. Pour la première fois j’entends de l’arrière et presque en sécurité le roulement de tambour des grandes batailles, et jamais je ne me suis senti le cœur aussi serré d’angoisse ». Son régiment est en réserve et doit attaquer dès le 23 février. Le 24, il note « Soirée atroce. Les routes sont encombrées de troupes, d’artillerie, de convois de ravitaillement. Les villages brûlent et des maisons s’écroulent pendant qu’on passe. Mais il faut y passer vite, à travers les débris, les trous que les obus ont creusés dans la route, les poutres, les véhicules écrasés, les chevaux morts (…) ». On sent la panique, il finit par avoir des nouvelles de son groupe de mitrailleurs. « Le lieutenant Vaton, le bon père Laude, mes anciens caporaux, celui qui m’a remplacé comme agent de liaison, tous ces braves amis disparus ».
Il ne donne que peu de détails, exprimant surtout son inquiétude pour ses camarades et pour Carlo. « Il est impossible de concevoir un secteur à la fois plus important et plus négligé. En revanche, on avait pris soin depuis le début de la guerre que les cheveux de la troupe fussent coupés ras (…) il est pénible de voir réparer des fautes par un si grand sacrifice d’hommes », page 150.
Début mai 1916, il obtient sa deuxième permission.
Ce qui est passionnant à lire dans ce témoignage, c’est à la fois l’expression et la variation de ses sentiments pour Madeleine, mais aussi le destin individuel du soldat. Il le visualise lui-même très bien : il a quitté les mitrailleurs pour la CHR juste avant Verdun, puis la CHR pour redevenir mitrailleur juste avant la dissolution du régiment. Devenu caporal fourrier, il rejoint le 273e RI en juin 1916 avec un bataillon complet du 310e.
Le 11 juin, il décrit longuement sa fonction lors de deux changements de cantonnement. Au détour du nom des camarades qui dorment dans la même chambre, il glisse « ces noms ne peuvent vous intéresser, mais peut être plus tard serai-je heureux de les retrouver », page 167.
Le 1er juillet 1916, il fait allusion à l’offensive de la Somme. A la vue de prisonniers allemands, il explique que les plus éloignés de la première ligne sont souvent les plus féroces : « Les plus embusqués, les plus vieux et les plus méridionaux se distinguaient dans le clan de la férocité », page 177. Juillet 1916 est en partie consacré à des discussions autour du mariage avec Madeleine, mais aussi sur le fait qu’« Hélas, ce sont les meilleurs qui s’en vont. Que restera-t-il . Mais nous avons les embusqués. Ce sont les sauveurs de la France », page 181. La guerre ne revient que le 30 juillet quand il narre les nuits sous les bombes et l’incendie d’un dépôt de munitions. Comme d’autres, il a des problèmes de dents (page 189). Il est sensible aux confitures !
Les anecdotes se succèdent dans ses écrits. Il raconte l’histoire d’un chat « J’ai fait la connaissance d’un petit chat qui me rappelle Poutchi. C’est le chat des artilleurs lourds d’en face. Il saute en l’air tout le poil dressé, à chaque coup qui part de la batterie, mais retombe endormi », page 190.
Il interroge ses camarades sur leur croix de guerre. « D’habitude ils ne savent pas bien pourquoi ils ont risqué leur vie volontairement, et il faut quelques temps pour le démêler », page 190.
La proximité d’une batterie lourde de quatre pièces lui fait bourdonner les oreilles. Quand le 3 août elle doit tirer 100 coups par pièce, il note « Zut ! 400 fois l’ébranlement cérébral, c’est trop. », page 191. Il va derrière les pièces et voit « les obus partir, monter haut dans le ciel comme une pierre qu’on jette, et s’y perde ».
À l’occasion de la rencontre avec un ami, il évoque sans retenue ses souvenirs de la journée du 6 août 1916 : « Les tranchées autour de nous étaient toutes bouleversées et parsemées de cadavres. On entendait ça et là des blessés appelant au secours avec des voix d’enfants (…). Les hommes qui allaient se battre avaient des visages ternes et des yeux d’animaux qu’on torture », page 192.
- Des réflexions sur la guerre
Le 6 août 1916, il parle des soldats blessés et malades. Il critique le peu de soins apportés : « La chair à canon n’a pas le droit de se plaindre. Et c’est bien embêtant qu’on ne puisse l’empêcher de penser », page 193.
Il décrit la première ligne dans le secteur de la Somme le 8 août 1916, « La zone des tranchées ressemble au désert, c’est un vaste espace de vagues immobiles pareilles à celles que fait le vent dans les sables d’Afrique », page 194. Toujours à la même page, il trouve la tombe du sergent Sage dont il réalise une belle évocation. Sous le feu de la Somme, au bois étoilé, il affine encore le portrait de la guerre et sa réflexion. Il évoque les mouches omniprésentes et « le peuple puce, aussi haïssable que le peuple mouche, est entré en campagne et m’a « grignoté » – système Joffre ».
Il poursuit ses réflexions sur la pensée militaire. « N’essayons pas de comprendre » est une formule devenue universelle de la philosophie du front. C’est une bonne formule. Elle admet tout sans rien excuser (…). Quand quelqu’un dit d’une chose « c’est bien militaire », tout le monde comprend « c’est totalement idiot ». D’autre part « c’est civil » ne veut plus du tout dire c’est civil, mais au contraire « c’est grossier ». Être civil, c’est traiter les autres comme des chiens ». Page 196.
Derrière certaines généralisations, c’est en fait son point de vue qu’il exprime, qu’il cache derrière le propos globalisant. Un bon exemple est donné page 197 lorsqu’il écrit « C’est le repos qui nous rend capables de recommencer car le combat n’aguerrit pas. Au contraire, à mesure qu’on échappe à de nouveaux périls il nous vient une appréhension plus grande des périls futurs ».
Il observe à propos du mélange des troupes « Les vieux, qui tiennent à leur vieille peau, démoralisent les jeunes » avant de poursuivre sur ses réflexions autour de la poursuite du conflit. « Nous ne sentons plus notre patriotisme parce qu’on l’a trop chatouillé. Toute excitation est suivie de fatigue et de réaction », page 197. « votre propre vie aussi ne vous semble pas plus importante que celle de n’importe quel hoplite obscur tombé sur un champ de bataille d’autrefois dont on ne sait plus que le nom », page 198.
Plus fine encore son opinion sur cette guerre qui pourrait être la dernière : « Cependant, on nous parle de la dernière des guerres. Celle-ci doit les rendre impossibles. Naïveté. Il y a trois ans, c’était l’armement à outrance qui les rendait impossibles », page 203 (22 septembre 1916).
Zone intérieure et zone des armées l’empêchent de voir un ami, bloqué de l’autre côté de la Marne. Présenté pour devenir officier, il intègre l’école d’officiers fin novembre 1916. Il critique les embusqués tout en cherchant à s’embusquer (interprète, caporal fourrier, officier, permission longue en Asie).
Les fiancés se découvrent par l’intermédiaire de leur correspondance. Parfois tendue, parfois passionnée au rythme du tutoiement ou du vouvoiement, des reproches, de la vie rêvée, de la question du mariage…
L’année 1917 est très brève dans le livre, même si elle est très riche dans la vie d’Henri Fauconnier : il devient sergent, suit l’école d’officiers, se marie enfin, part en permission en Malaisie, sa femme tombe enceinte, ils vont à Saïgon pour l’effort de guerre. Rappelé en France comme interprète, il laisse son épouse en Asie, craint pour sa vie sur le chemin du retour. Le contraste avec le premier retour en métropole est flagrant.
L’année 1918 commence au dépôt des interprètes. Les courriers sont désormais un mélange de remarques politiques entre ses soins dentaires. Par exemple, il parle des parlementaires en ces termes le 13 janvier 1918 : « En attendant on les déteste en France de plus en plus. Surtout Caillaux. Mais les autres presque autant. Je suis heureux de le constater. Clemenceau est le seul qui devienne populaire, bien qu’il ait la main rude, ou à cause de cela. Il est bien dommage que nous ne l’ayons eu dès le début au pouvoir », page 268.
En février, il note : « En France on a été très injuste pour la Révolution russe, personne n’y a rien compris. Il n’y a eu que des insultes pour Lénine et Trotsky (…) Et peut-être que ce seront ces hommes-là qui auront sauvé l’Europe », page 273.
Envoyé à Ham en février 1918, « on ne peut que s’étonner de l’absence quasi complète de toute allusion à la guerre dans ses courriers, aussi bien sur les grands événements que sur son sort individuel. Il ne pense qu’à sa famille, son bébé, son épouse, ses amis. La seule remarque est sur l’arrière et les combattants, le premier ayant des va-t-en guerre, le second des personnes qui veulent la paix.
À l’exception des quelques allusions à la situation (offensive allemande de juillet, avancée française à l’automne et évidemment l’armistice, admiration pour Wilson), son détachement du reste de la guerre est toujours aussi palpable dans ses écrits. Il n’y parle que d’avenir, des affaires en Asie, des problèmes de santé de son épouse. Page 307, il critique Barrès quand il dit qu’il a vu de l’arrière la guerre en automobile. Il est question des permissions difficiles voire impossibles à la frontière espagnole.
Dernière étape, la démobilisation est à peine évoquée.
- En guise de conclusion
Très bien écrites, ces lettres sont passionnantes à découvrir tant elles sont riches dans de nombreux domaines : l’aventure asiatique en arrière-plan, une présentation sobre et factuelle avec une belle plume de ses deux années en première ligne, les péripéties de sa vie amoureuse à distance avec Madeleine. Ces lettres, sans être à proprement intimes, n’en dévoilent pas moins de nombreux éléments de cette relation passionnée tout autant qu’électrique.
L’année 1917 est charnière car elle permet à Henri Fauconnier de faire une pause dans la guerre sans ensuite vraiment y revenir, de se marier, de retourner en Asie avant de devenir père. Les courriers ne sont plus les mêmes ensuite, y compris dans sa vision de la guerre. Il veut en revenir. Si l’homme reste soldat, la démobilisation de son esprit n’en est pas moins flagrante.
- Compléments :
Fiche matricule d’Henri Fauconnier, classe 1899, matricule 343 au bureau de recrutement de Périgueux, Archives départementales de Dordogne, 02R0906.
Extraits de l’ouvrage et photographies d’Henri Fauconnier :
https://www.14-18hebdo.fr/henri-fauconnier-lettres-a-madeleine-15-fin-novembre-1918
Extraits de l’ouvrage sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k48055979.texteImage
