GABOLDE Maurice, Les carnets du sergent fourrier, souvenirs de la Grande Guerre, Paris, L’Harmattan, 2013.
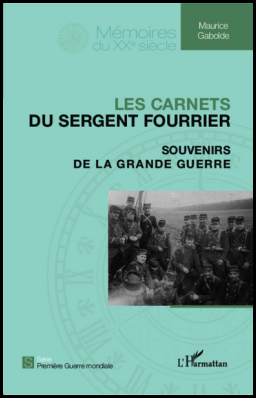
Qu’il n’y ait pas de méprise concernant les propos qui vont suivre : à mes yeux, tout témoignage vaut d’être publié, celui-ci aussi. D’abord parce que chaque point de vue affine notre connaissance du témoignage des combattants. De celui qui n’écrit que des éléments factuels à celui capable de prise de distance vis-à-vis de ce qu’il vit, tout témoignage s’intègre dans cette vaste typologie qui structure l’écrit des combattants. Ensuite, parce que ces témoignages croisés précisent notre vision du conflit à leur échelle, un siècle après. Et pour tout dire, grâce à Internet et depuis la fin 2013 une foison de publications « papier » (inédit ou en réédition) ainsi que la Grande collecte ont littéralement inondé le lecteur de matière. Au point qu’il ne peut plus tout absorber (et je poursuis la métaphore du liquide…) et que pour lui se pose la question de savoir s’il faut publier tous ces témoignages à n’importe quel prix. Car le nerf de la guerre, outre le temps, est bien là : le coût très élevé de cette somme de publications. L’exemple qui suit est, à ce titre, significatif : 33,00 euros pour une transcription illustrée d’un témoignage.
- La question du prix
33,00 euros, c’est plus que pour les ouvrages de Sentilhes ou bien de Viguier, qui, en plus d’être riches, sont illustrés d’un nombre considérable de photographies inédites. C’est donc plus que ce que j’accepte en général de consacrer pour un témoignage ou une correspondance. Obligatoirement, se pose alors pour le lecteur la question de savoir si le témoignage proposé en vaut le prix.
La réponse n’est pas aussi simple car il ne s’agit pas de carnets de guerre mais bien d’une réécriture a posteriori. Peu importe ici le temps qui sépare les faits de leur mise en mots. Dans la première partie de l’ouvrage, l’auteur a eu une volonté évidente de se mettre en scène, de réinterpréter ce qu’il a vécu à l’aide de ce qu’il a appris ensuite, dans un phénomène parfaitement décrit par Lecaillon. On reconnaît aisément ce style d’écriture à l’utilisation fréquente du futur, ce qui donne un style très particulier à ce récit. Tout semble joué d’avance, l’auteur devient une sorte de prophète. Ce style, on peut ne pas aimer, surtout que la grande majorité des témoignages n’en font pas un usage aussi fréquent.
On a aussi un mélange entre ce que vit cet homme à son niveau et ses digressions postérieures sur la situation tactique, l’évolution de la bataille (qu’il dit lui-même ignorer quand il était au front). Ce choix est d’autant plus dommage car il fait s’interroger sur la part de mise en scène de l’auteur dans le récit de sa propre expérience. Heureusement, les deux autres parties du récit sont dans un tout autre style. Ce récit se caractérise par une grande densité et une relation quotidienne où l’auteur ne cherche pas à se mettre en valeur.
- Les illustrations
Pour qui va sur Internet et consulte des sites ou des blogs sur la Première Guerre mondiale (et ce constat est valable pour tous les autres thèmes d’ailleurs), c’est un phénomène fréquent : l’appropriation d’images. De nombreux sites se nourrissent de ce que leur auteur trouve sur Internet. Certains ne fonctionnent même que sur ce principe, sans même se donner la peine de citer la provenance des documents. Pourtant, ce qui est visible sur le net (et si facilement récupérable) n’est pas par définition libre de droits et donc librement utilisable. Quel rapport avec le présent ouvrage ?
Il est illustré par 78 images. Je passe sur le format trop petit de ces illustrations et sur la piètre qualité d’impression pour n’insister que sur un point que je constate pour la première fois dans une édition papier : la réutilisation d’images trouvées sur Internet. Certes, l’auteur a consacré une page pour citer l’origine des images mais d’une manière fort maladroite : les crédits photographiques ne donnent souvent que l’adresse Internet du site sans préciser s’il y a eu accord de l’auteur dudit site. Avec le comble pour l’illustration 3 : « crédit photographique inconnu » !
Mais là, c’est surtout le travail de l’éditeur qui me surprend : comment a-t-il pu laisser passer ce type de pratique, jusqu’alors réservé à Internet ? Même si l’Harmattan est connu pour ne faire que l’impression et la diffusion de l’ouvrage, un minimum d’accompagnement sur les aspects légaux serait bien utile. Surtout au prix qui est demandé au final !
Ce qui est encore plus gênant, c’est que la grande majorité des illustrations n’apporte absolument rien à ce qui est écrit : de petite taille, de qualité médiocre ces images sont souvent des reprises de cartes postales sans grand intérêt. Je fais une exception notable à cette critique : les photographies et les documents originaux provenant de l’auteur sont d’une pertinence évidente. Tout le reste n’est que fioriture, inutile par définition, dont le retrait aurait permis de grappiller, peut-être, quelques précieux euros.
La belle photographie de couverture est, au contraire, insuffisamment exploitée. Première question : où est-il sur la photographie ? Il n’est pas encore sergent-fourrier (de toute manière, il n’y en a pas sur l’image). Seule certitude : elle a été prise avant-guerre au cours d’une de ces marches dont il parle dans son récit. Cette image met en évidence le manque d’informations sur sa jeunesse. Tout au plus sait-on qu’il est né en 1891, qu’il a fait du droit. On en apprend plus sur le manuscrit (ce qui n’est pas inintéressant) que sur son auteur. Il faut attendre la page 22 pour comprendre qu’il est au 69e RI de Nancy, régiment de couverture dont les hommes sont rapidement mis sur le pied de guerre, avant la mobilisation.
- Un livre à oublier ?
Non, tel n’est certainement pas mon propos. Ce livre n’est pas le seul méritant ces critiques. S’il n’avait aucune qualité, je ne l’aurais ni terminé ni chroniqué. Les critiques faites sont sur la forme, le fonds est extrêmement riche et intéressant. En effet, chaque journée est détaillée (parcours, missions…) ce qui permet de suivre au plus près l’unité. On en vient rapidement d’ailleurs à regretter l’absence de cartes tant les mouvements sont précis et le choix d’indiquer la localisation de chaque lieu en note de bas de page complique la lecture et se révèle totalement inutile à mes yeux.
Il narre en détails certaines journées ou certaines périodes, évidemment celles où l’auteur et son régiment se sont retrouvés face à l’ennemi. On a alors un tout autre style de narration, où les futurs sont rares, où l’on sent l’inquiétude, le stress même, où on voit tomber ses camarades, des officiers. On découvre ainsi la bataille du Grand Couronné (août-septembre 1914) puis la Course à la mer du point de vue d’un homme noyé au cœur d’une suite de combats.
Si l’on s’en tient au témoignage, il est clairement de premier ordre : sa densité, sa richesse en font un témoignage à recommander. Ses fonctions particulières donnent au récit un angle vraiment différent : celui d’un sergent-fourrier. Il nous fait découvrir la gestion des effectifs : la tenue des états, leur mise à jour après les combats, parfois avec retard, les conditions d’affectation des territoriaux arrivés en renfort à partir d’octobre 1914 n’en sont que quelques exemples.
On perçoit aussi très bien l’évolution de la manière se battre depuis le début de la guerre : les charges d’août, la poursuite en septembre, la guerre de rencontre que fut la Course à la mer puis l’enlisement progressif sont parfaitement rendus par les mots de l’auteur. À partir du mois d’octobre, le secteur où se bat le régiment est l’Artois, avant qu’il ne soit sous les feux des projecteurs en 1915.
Les pages d’août-septembre 1914 sont déjà très intéressantes, celles sur octobre sont passionnantes. Les repos sont rares, l’ennemi est proche, le front n’est pas encore fixé. Par moment, le ravitaillement est rare, on vit sur le pays. Le 26 octobre, il écrit : « Nous ne savions même pas qu’il y avait un front continu d’Alsace à Lille et ignorions tout des événements (…). On se rend compte qu’on a vécu une sorte de fièvre » (page 117).
Cet homme est de l’active : il était à la caserne au moment du déclenchement du conflit. Il a des mots significatifs à ce propos. Le 2 novembre, le régiment est réuni : « À Pommier, on trouve les 2e et 3e bataillons (…). On cherche des figures connues, mais les interpellations sont rares. Le temps va vite en guerre, et les hommes ne durent pas longtemps. Je songe à ces marches du temps de paix sur les routes des environs de Nancy, aux lazzis, aux poignées de mains nombreuses, aux sourires de reconnaissance échangés, car il n’était de compagnie où l’on ne connaît quelqu’un. Rien de pareil. Les détachements de renfort ont remplacé l’active dont les survivants se font plus rares chaque jour (…). » page 119.
Le même jour, autre détail montrant la richesse du texte, il note « Je peux enfin quitter ma loque de pantalon déchirée depuis Montauban et qui n’avait plus de rouge que le nom et enfiler un pantalon de velours vert sur un caleçon propre » page 120.
L’évocation des combats de Saint-Eloi en novembre 1914 est d’une grande intensité également. La première nuit est tout particulièrement décrite et les éléments sont très précis et nous rendent parfaitement compte de l’enchevêtrement des combattants dans la nuit, le rôle d’un agent de liaison. Ces pages sont une fois encore bien plus intenses que les quelques lignes consacrées à ces journées dans bon nombre d’autres ouvrages. Cartes imprécises, manque de réserves, intensité des attaques allemandes…, il observe car il est en arrière de la première ligne, comme agent de liaison.
- Un texte en trois parties
Si la structure du récit fait apparaître un découpage autour des différentes périodes de combats successives, l’ensemble est en fait structuré en trois temps. C’est probablement à la fois le signe d’une écriture en trois fois, mais aussi la mise en évidence de deux moments très forts séparés par une période « calme ».
La première est celle qui a déjà été évoquée, de la mobilisation à novembre 1914. C’est la partie marquée par les futurs, par des références générales sur la guerre. Le récit est quotidien.
La deuxième partie est d’une forme totalement différente. Le régiment est en Belgique, le récit est thématique après une transition narrant les combats du 24 novembre. Il n’y a pratiquement plus de futurs et de considérations générales. Il décrit chacun des secteurs occupés successivement par le régiment et, à chaque fois, les cantonnements. Pour ce dernier point, il l’agrémente d’un croquis et d’informations très intéressantes sur ces cantonnements. Il indique les grandes étapes chronologiques de cette période (La Forge, s’Gravenstafel…). Il achève cette partie par un portrait de ses camarades et le seul combat significatif de ce qu’il nomme sa « campagne d’hiver ». Ces pages montrent que son grade et son affectation font qu’il vit une guerre différente, qui n’est pas sans risque. Cet ensemble fait 55 pages malgré 6 mois de récit, mais c’est une période où il n’a pas estimé nécessaire de faire autant de développements. Il a axé son texte sur les lieux et surtout les hommes.
La troisième partie reprend un récit quotidien, aussi riche et détaillé que dans la première partie, sans les futurs et les considérations généralistes. Les seules remarques s’écartant du récit concernent les pertes de ses amis.
Même s’il ne participe plus aux assauts, il est tout de même très régulièrement en première ligne, dans le nouveau secteur occupé par le régiment, l’Artois, à l’occasion de l’attaque du 9 mai 1915. Il ne retourne à l’arrière et ne peut boire une eau correcte qu’au bout de 17 jours. Les combats de Neuville-Saint-Vaast sont décrits en détail, avec une grande précision sur les lieux et qui rendent très bien compte de ce que fut cette période particulière et sanglante. L’auteur est toujours en mouvement, accompagnant des troupes vers l’avant, passant de longues journées dans la zone des combats. Il doit aussi régler des problèmes de cantonnement ainsi que l’arrivée de la classe 1915 ce qui lui fait écrire page 260 : « Ainsi, toujours et éternellement la même vie : détachement de renfort, bataille, casse, repos ; et le cycle recommence ».
Et puis c’est le retour en ligne en juin pour attaquer à nouveau en Artois. La description des combats du 7 juin est aussi riche et intense : l’organisation du secteur, le travail de la nuit nivelé en quelques heures de bombardements dans la journée, les effets terribles du pilonnage sur les hommes en général, baptême du feu de la classe 1915. Même les anciens en ressortent brisés. Le 9 juin, il décrit les effets de la pluie sur les parois associés au bombardement : le travail est ruiné, les hommes s’épuisent.
L’ouvrage se termine sur l’attaque du 16 juin 1915, où les hommes débouchent à peine dans certains secteurs. Il a d’ailleurs l’occasion de faire le coup de feu. Sa blessure clôt son témoignage. Une dernière partie évoque le parcours de son régiment jusqu’à la fin de 1916, ce qui laisse penser que l’ensemble fut achevé à cette date.
- En guise de conclusion
Passés ce qui représente des défauts à mes yeux, à savoir les illustrations inutiles, le trop grand nombre de notes de bas de page, on a un témoignage d’une grande richesse, d’une grande intensité, qui mérite vraiment d’être découvert. Il est fréquent que les témoignages des combattants perdent en précision et qu’ils deviennent plus hachés à mesure que le temps passe. Ce n’est pas du tout le cas ici, même si la deuxième partie est moins détaillée et plus thématique. Elle n’en donne pas moins une vision très intéressante de la période du régiment en Belgique.
Je regrette pour finir que la suite de son parcours ne soit évoquée qu’à demi-mot, de manière fort allusive. Autant ne pas en parler surtout que ce qui est intéressant ici est le récit d’un combattant qui a repris ses notes juste après sa blessure. Comme l’indique la 4e de couverture, Maurice Gabolde « happé par la tourmente de l’Occupation… termina sa vie en exil en Espagne » périphrase pour ne pas dire qu’il fut un haut responsable du gouvernement de Vichy. Mais c’est une autre histoire.
