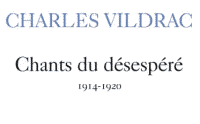VILDRAC Charles, Chants du désespéré, Paris, Gallimard, 2016 (1920), 110 pages.
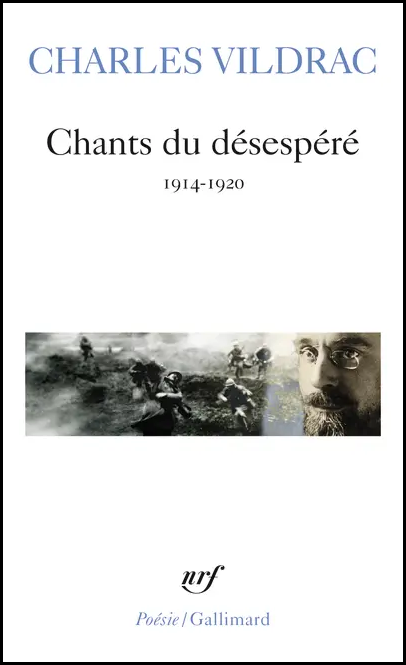
Un nouveau volume dans une collection, peut-être est-ce ainsi que la direction des éditions Gallimard accepta cette publication ? En tout cas, cela ne coûta probablement pas beaucoup plus que la mise en page et le graphiste pour la couverture. Car pour le reste, il s’agit ni plus ni moins d’une republication de l’édition de 1927 des poèmes de Charles Vildrac tirés de son expérience de la Première Guerre mondiale. Aucune présentation, aucune analyse ou aide à la lecture, tout juste une « bio-biographie » indigente qui indique que les poèmes furent « composés au cœur même des combats », ce qui n’est vraiment pas le cas. Il en commença la rédaction en 1918 alors qu’il était à la section de camouflage. Pire, la version numérique ne dispose même pas de la pagination originale vu qu’elle n’a pas de pagination. Une publication à l’économie qui ne met pas en valeur l’œuvre de Vildrac un siècle après sa première édition. D’ici à imaginer que l’idée de l’éditeur fut de surfer sur le Centenaire…
Il existe pourtant une très belle édition illustrée par Oscar Eichaker1, mais dans une autre maison d’édition.

Elle comporte une gravure illustrant le tourment du poilu derrière lequel on peut deviner les traits de Vildrac. Le corps est replié, la capote se fond avec le haut du corps en un tout noueux. Tout est douleur et tristesse dans cette gravure. Le fond ressemble à un ciel pluvieux et sombre. On est aux antipodes du combattant debout, fier, héroïque vanté par la presse et une certaine littérature de l’époque. Ces écrits étaient d’ailleurs combattus par Vildrac. Dommage de ne pas avoir intégré ces plus dans la présente édition une fois encore. Restent les vers d’une grande richesse évocatrice et stylistique.
- Une œuvre humaine au cœur d’une tragédie
La guerre fut une tragédie pour Vildrac. Il explique dans ses souvenirs qu’il ne put créer à nouveau qu’en 1918. Ce qu’il vivait, ce qu’il observait, ce qu’il subissait, tout cela mit entre parenthèses ce qu’il était avant-guerre. C’est à la faveur de son éloignement de l’horreur du front par son affectation dans la section de camouflage qu’il retrouva son envie. Et la première œuvre fut ce recueil de poèmes.
Les adjectifs pour qualifier sa poésie sont nombreux : évidemment pacifiste, mais surtout profondément humaine. Et c’est là qu’est le tragique : chaque poème dit ce que la guerre prend, enlève, détruit. Tous ont comme point commun de dire le tragique pour les humains que cette situation imposée, folle. Les écrits de Vildrac sont profondément humains car tout tourne autour de cela : ses ressentis, ses blessures intérieures, la violence sous toutes ses formes. La contemplation de la nature lui rappelle à quel point la situation est absurde, aberrante.
Chaque poème évoque une personne, que ce soit dans la dédicace ou dans le texte lui-même. Chaque poème dit la perte, l’absence d’un ami, d’un camarade disparu à la guerre, mort qui éteint un être individualisé, apprécié, aimé, au nom d’une guerre dont le principe même lui est insupportable. On comprend alors le sens de son titre : il est désespéré par tout ce qui l’entoure, qui a tué ce qu’il était ainsi que des êtres chers.
- Variations autour de son vécu
Chaque poème est issu de son parcours, de ce qu’il a vécu, principalement en 1914-1916 lorsqu’il était fantassin, avant son départ du front ainsi que de ce qu’il reste en lui de cette guerre une fois terminée. Il ne s’agit pas d’en faire une analyse stylistique mais d’en montrer simplement le lien avec la guerre. Une partie de ces résumés doit beaucoup au travail réalisé par Georges Monnet pour la publication des Souvenirs militaires de la Grande Guerre2.
Dans « Chant du désespéré », première pierre à son renouveau artistique qu’il signale dans ses souvenirs, il utilise des oxymores, des mots opposés au sein d’un même vers. Il y montre sa dualité de mobilisé « Plein de mort et plein d’amour ! »
Passée cette introduction, il évoque dans « Mobilisation » la vie de caserne pendant son séjour au dépôt, mais pour dénoncer une vie abêtissante, rendue encore plus insupportable par des officiers embusqués.
«Avec l’heure » évoque la nature et plus particulièrement les arbres et l’herbe. C’est le décor de cette guerre de 1914. L’herbe, c’est ce qu’il voit couché au sol pour survivre aux tirs ennemis.
« Brins verts contre ma bouche et que mon souffle fait trembler,
Je vous confie la détresse de l’homme »
Ce poème est dédié à Berthold Mahn, un ami d’avant-guerre retrouvé à la section de camouflage.
« Souvenirs » est dédié à un ami pacifiste, Georges Pioch (page 190 de ses Souvenirs). Il évoque les souvenirs douloureux qui s’accumulent sans trouver d’exutoires jusqu’à ce qu’au bout de trois ans Charles Vildrac retrouve enfin le goût des mots et de l’écriture. Il évoque donc ce moment particulier où le besoin de dire avec ses mots et sa manière a été plus fort
« Et c’est là qu’enfin mon cœur
Pourrait délivrer
Sa colère et sa douleur,
Sa honte et ses larmes. »
Son « Chant du fantassin » est un cri de désespoir. Il liste des cas tragiques que personne n’envie, le vieillard ou l’aveugle. Pourtant, malgré leurs malheurs, ils sont plus enviables que le fantassin. La conclusion de Vildrac est terrible : mieux vaut mourir que de subir la vie de fantassin et ses horreurs.
Dans « Trêve », il savoure la nature « Et pour oublier que je suis / Dans le deuil et dans la guerre. »
Dans « Relève », il s’interroge sur les hommes qui reviennent de première ligne et qui oublient, qui se remettent à vivre, « Et pourtant ! Les tués d’hier ! ». Chacun veut vivre, se complaît dans un quotidien de vie, y compris en dormant dans une étable.
« Printemps de guerre » évoque la nature qui se réveille et qui est condamnée par la guerre, que ce soit l’arbre, le papillon. Même l’herbe l’est mais par le propre corps de Vildrac.
« La Grange » décrit un petit espace vu par ce combattant observateur. La construction est souvent la même, se terminant par la surprise finale : ici, la grange est détruite.
« Montblainville » est un lieu de repos pour Vildrac en 1915 (page 62 de ses souvenirs). Comme dans le précédent poème, il évoque un lieu abandonné par ses occupants. Mais seuls eux et lui auront le souvenir de ce lieu désormais détruit.
« Intermède » est la mise en mots d’un souvenir d’Amiens en 1916, un moment de vie qui le toucha. La date n’indique pas le moment de création mais bien le souvenir (page 244 des Souvenirs).
« Cher Peuple » parle des blessés pour qui il peut si peu. C’est une nouvelle fois l’occasion pour Vildrac de dire toute l’humanité qui semble disparaître dans cette guerre.
« Élégie à Henri Doucet, tué le 11 mars 1915 » est au cœur de ce recueil (page 91 des Souvenirs). Ce chant pour un mort est divisé en quatre parties. Dans la première partie, il file la métaphore autour de l’arbre. Chaque branche est une personne, certaines branches se déploient plus que d’autres. C’est une de ces branches différentes que la guerre a coupé. Il fait une présentation factuelle de son ami avant de revenir sur sa mort, sacrifié au profit des intérêts d’autres. La deuxième partie est consacrée à Châtellerault, commune d’origine d’Henri Doucet. Il évoque surtout la visite faite à sa famille après-guerre où il rencontra ses parents, sa sœur et sa fille. Le père est évoqué dans la troisième partie afin de mettre en évidence un paradoxe : le père aima son travail pour fabriquer les Lebel, il aima son fils, mais ce sont les armes de ce type d’usine qui tuèrent son fils. Il termine en remettant en question le concept de « victoire » : pour lui, pas de victoire quand tant de personnes sont mortes, y compris, évidemment, son ami.
Dans « Élégie villageoise », c’est pour Jean Ruet, dit Ramoulu, qu’il écrit. Camarade brancardier, il a été blessé au ventre par des éclats de grenade puis est mort au milieu de son groupe, accompagné par Vildrac (page 142 des Souvenirs). Une fois encore, ce dernier évoque sa famille et ses drames et surtout tout ce qui faisait l’humanité de Jean Ruet.
Le dernier poème de la première édition s’intitule « Europe ». Il reprend son allégorie autour de l’arbre.
« Retour de la guerre » évoque le chant, comme nombre de ses poèmes, en lien avec le titre. Il écrit sur ce qu’il a vu, ce qui le remplit désormais et le fait s’interroger sur ce qu’il est encore capable d’écrire.
« Il y a d’autres poèmes » qu’il n’a pu ou pas voulu écrire. S’il n’a pas de haine, il a de la colère contre les personnes glorifiées par cette guerre, par ceux qui en ont profité. Il ne veut pas sombrer dans la colère qui pour lui est stérile. Ce qu’il a vécu l’emplit et l’empêche de dire.
« La guerre est encore vivante
Et pesante en moi comme un mal
Qu’on n’arrive pas à guérir ! »
Il veut alors se concentrer sur ces humanités rencontrées, sur les joies, sur la vie.
« Élégie » est un nouveau chant qui se concentre sur le pouls dans son pouce qui lui rappelle qu’au milieu des affres de la guerre, il est vivant.
« Chanson d’hiver » est un message d’espoir à une jeune personne.
« Retour en Argonne » est un poème dédié à un camarade, André Rouchaud. Il évoque le retour en Argonne en 1923 (après la publication de la première version des Chants du désespéré). Il ne mentionne hélas pas ce voyage dans la publication des résumés de ses carnets de 1922 à 19683iii.
« Le jardin » est dédié à Jean-Richard Bloch, ami d’avant-guerre, qui a échangé des lettres avec Vildrac tout au long de la guerre et rencontré en Italie en 1918. Il s’agit d’une histoire de deux gars du Nord après-guerre.
- En guise de conclusion
On ressent toute la violence de la guerre et les traces qu’elle laissa en Vildrac. Il est un des rares à dire cette expérience d’ancien combattant marqué intérieurement par l’horreur de la guerre. Il l’exprime par la poésie et par un art de la métaphore et de l’allégorie liées à la nature. On peut découper les œuvres de Vildrac en deux catégories : ses poèmes liés à des expériences strictement militaires et ceux plus spécifiquement liés à la mémoire d’un camarade.
Cet ensemble est à découvrir avant ou après la lecture des Souvenirs de Charles Vildrac. La lecture de ce témoignage donne sens et permet de bien comprendre l’œuvre, ce que la « bio-biographie » ne permet vraiment pas, tout comme l’absence de notes.
- Remerciements :
A Stéphan Agosto pour m’avoir fait découvrir cet auteur. Quand les réseaux sont ce que l’on attend vraiment d’eux !
- Pour aller plus loin :
Souvenirs de la Grande guerre de Vildrac, compte rendu de lecture :
Notice dans le site Poésie Grande Guerre :
Une très belle biographie de Charles Vildrac réalisée pour le cinquantenaire de sa mort mis en ligne par la mairie de Créteil (au format pdf) :
https://www.ville-creteil.fr/PDF/PDF-actu/2021/Hommage-Charles-Vildrac.pdf
- Pour en savoir plus sur Oscar Eichaker ; https://fr.wikipedia.org/wiki/Oscar_Eichacker
Illustration provenant du site de vente https://www.abebooks.fr/art-affiches/Chant-dun-Fantassin-Charles-Vildrac-Eichaker/30825578979/bd, consulté le 15 avril 2025. ↩︎ - VILDRAC Charles, Souvenirs militaires de la Grande Guerre, Paris, Éditions Claire Paulhan, 2021, 288 pages. ↩︎
- VILDRAC Charles, Pages de journal, 1922-1966, Paris, Gallimard, 1968, 288 pages. ↩︎