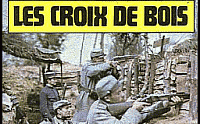DORGELÈS Roland, Les Croix de Bois, Paris, le livre de poche, 1987 (édition originale 1919), 288 pages.

Ce livre fut probablement le premier que j’ai lu sur le sujet, jeune adolescent. Je ne l’ai relu qu’une fois, il y a largement plus de dix ans. Cité en référence bien souvent, je l’ouvre à nouveau.
Le lire est une chose, écrire un petit article dessus alors que tant a déjà été publié en est une autre. Il a été analysé, décortiqué à de multiples reprises. On trouve sur internet des discussions, des compte-rendus de lecture d’élèves, de passionnés, de critiques très riches et même une thèse consultable intégralement1. Cette foison est tout à fait logique tant cet ouvrage est devenu un classique, si ce n’est le classique de la littérature sur les combattants de la Grande guerre. Il en a même été tiré un film qui est lui-même considéré par beaucoup comme l’un des films montrant le mieux ce que fut cette guerre.
Encensé par les uns, critiqué par les autres ; vu comme pacifiste bien souvent mais pas par son auteur, les Croix de Bois est un livre à part. Un peu témoignage, un peu roman, il est un récit réalisé à partir du vécu de Dorgelès au 39e RI de septembre 1914 à septembre 1915. Son récit est réécrit, romancé, avec des personnages inspirés de ses compagnons sans être eux. Il n’écrit pas comme Genevoix. Même si on perçoit les grandes étapes suivies par ce régiment, ce n’est pas son but. Aucune unité n’est mentionnée qui rend son récit universel et transposable à n’importe quel secteur du front. L’absence d’élément chronologique précis renforce cet effet.
Ce qui fait la force et le succès de cet ouvrage est la simplicité de lecture de cette écriture et une immersion unique dans l’univers si particulier d’un groupe de combattants.
Le style, en effet, est remarquablement clair et permet une lecture rapide. Ce qui ne veut pas dire qu’il soit pauvre ; au contraire les situations sont suffisamment détaillées pour permettre l’immersion du lecteur. Lecteur qui lira d’autant plus vite l’ouvrage car le récit et l’unicité de chaque chapitre donnent envie d’avancer.
On est donc, avec cet ouvrage, au cœur du thème de ce site, le parcours de combattants de la guerre 1914-1918 et c’est dans cette optique que j’ai écrit ces lignes : en quoi nous aide-t-il à comprendre les combattants, leur vie ?
Les thèmes abordés par chaque chapitre donnent une bonne idée de la vie quotidienne de ces hommes, de leur mode de pensée, de fonctionnement, de leur diversité (sociale, culturelle, de point de vue). Même si l’auteur a pris volontairement des personnages aux profils très différents (culturel, social, géographique), cela n’enlève rien à la qualité de ce que Dorgelès nous narre.
- Les chapitres
I. Frères d’armes :
Arrivée de trois bleus à la 5e escouade de la 3e compagnie. L’accueil un peu viril de la part des anciens permet de découvrir les individus qui composent ce groupe : le caporal Bréval, le cuisinier Fouillard, le père Hamel, l’agent de liaison Lagny, Bouffioux, petit Belin, Broucke du Ch’nord, Sulphart. Le narrateur, Jacques, reste très en retrait bien qu’étant présent parmi les anciens.
Les bleus découvrent le front, écoutent les anciens parler de leur campagne. On y découvre un long laïus sur la retraite et sur ce que la Marne leur a rapporté : une victoire abstraite, 15 sous concrets !
En fait, c’est une longue introduction montrant le fonctionnement du groupe, la mentalité des individus, leur cohésion. Si les anciens s’amusent de la naïveté des nouveaux, c’est sans malice mais pour mieux leur prodiguer des conseils. Ainsi, Sulphart prend Demachy sous son aile : il devient son « ancien », sans que l’expression ne soit utilisée, et Demachy « son bleu », dans une tradition de caserne fortement ancrée.
Le lecteur, comme les bleus, intègre le groupe, va vivre avec lui, car c’est bien là le but du livre : permettre au lecteur de comprendre ces hommes, ce qu’ils ont vécu, comment ils l’ont vécu. Dorgelès décrit minutieusement les odeurs, les techniques utilisées pour se protéger du froid la nuit, rendant l’immersion complète.
II. A la sueur de ton front :
Dorgelès poursuit son travail de présentation en racontant la corvée de ravitaillement pour laquelle Demachy, bien que tout nouveau, est volontaire. Il est secondé par Sulphart qui lui apprend les combines. On voit apparaître l’individualisme des hommes, loin de l’image des combattants unis. Mais cet individualisme a deux visages : on pense à soi avant tout, mais aussi à ce groupe auquel on appartient, l’escouade.
III. Le fanion rouge :
Le texte commerce par la longue description d’une marche où le narrateur développe la difficulté de l’exercice en prenant l’exemple du jeune Demachy. Une fois arrivé, le groupe va en ligne, s’installe dans les abris.
Une compagnie sort après un bombardement préparatoire. Elle est fauchée par une mitrailleuse allemande puis par un bombardement français trop court. Un homme agite sa ceinture de flanelle rouge pour signifier que le tir est trop court. Mais il est tué sous les yeux des hommes de l’escouade du narrateur.
Demachy nous fait découvrir le no man’s land : il est volontaire pour une patrouille de nuit. Les hommes ramassent les papiers et les plaques des soldats tombés dans l’après-midi. Mis en boite par les anciens, Demachy rapporte la preuve de ce qu’il a fait, mettant fin aux gentils sarcasmes et au chapitre.
Dorgelès utilise pour la première fois un type de chute qui se retrouve régulièrement dans le Cabaret de la belle femme et dans les Croix de Bois. Une chute couperet rendant inutile tout commentaire.
IV. La bonne vie :
Le groupe est une nouvelle fois au repos. Les hommes se préparent à la revue. Même s’il romance, les effets de réel (la partie sur les uniformes disparates par exemple, pages 56 à 58) permettent de s’imaginer parfaitement les combattants de l’hiver 1914-1915.
Dans ce chapitre, il aborde aussi la question de la peur. Bouffioux cherche toutes les opportunités permettant de s’embusquer. Il accepte de devenir cuistot. Son premier repas est l’occasion d’une mise en boite par les soldats du groupe car il n’a aucune connaissance particulière pour cette fonction.
V. La veillée d’armes :
Ce chapitre aurait pu s’intituler « la vérité sort des marmites » (dans le sens cuisines) si l’annonce de l’attaque prochaine n’avait été vraie. Dorgelès y expose, au détour de l’arrivée du ravitaillement en première ligne, les bruits qui circulaient, venant le plus souvent des hommes de l’intendance, des cuisines…
Une fois l’information confirmée, Dorgelès décrit son état d’esprit, celui de ses camarades. Il y pense pendant ses trois heures de garde. Il se rend compte et expose à quel point la guerre l’a marqué. Il imagine ce qu’il en sera quand il sera vieux. Mais sera-t-il vieux un jour ?
VI. Le Moulin sans ailes :
Dorgelès évoque les civils dans les villages où il est au repos. Ses mots sont durs comme les prix pratiqués ; il parle des femmes du village.
Surtout, il évoque la famille d’une ferme où son escouade dort et mange pendant les trois jours de repos. C’est l’occasion de retrouver un peu de cette vie d’avant, mais surtout de réfléchir à sa condition de soldat, à ce que cela a changé dans sa perception de la vie.
Dorgelès aborde des thèmes particulièrement sensibles. Il nous montre sa perception des choses. Comme cela a déjà été le cas par moment dans d’autres chapitres, nous ne sommes plus dans un roman.
VII. Le café de la marine :
Demachy va sur la tombe de Noury, récemment tué. C’est l’occasion de décrire le village, la cave où l’escouade est en attente, les habituelles querelles, chamailleries entre les hommes, et le secteur avec une anecdote sur les premiers mortiers en bronze de 1848 utilisés. Il parle aussi qu’une fronde à grenade utilisée par Sulphart.
VIII. Le Mont Calvaire :
« Il y avait plus de douze stations à ce chemin de croix ». Par cette simple phrase, Dorgelès résume la montée en ligne au milieu des croix, les hommes doivent monter en ligne dans un secteur très actif du front. Ils réfléchissent car il faut y aller. Le chapitre est connu : les hommes comprennent que les Allemands creusent une mine sous leur position. les esprits s’échauffent. Malgré le destin de la tranchée française et des hommes présents, il faut rester.
Que pouvaient ressentir les hommes dans de telles circonstances ? Que pouvaient-ils penser lors de la relève, se sachant sauvés, mais regardant en face les condamnés ? Dorgelès l’écrit.
IX. Mourir pour la patrie :
Très court chapitre où Dorgelès évoque l’exécution d’un soldat. Il exprime son point de vue sur cette condamnation, son déroulement, l’effet moral terrible sur le régiment obligé d’y assister.
Le titre est à la fois ironique et fait aussi référence à une chanson.
X. Notre Dame des Biffins :
Le régiment va monter à l’attaque. Certains boivent, d’autres prient, d’autres pensent. Tous espèrent.
XI. Victoire :
Un des chapitres les plus émouvants. Tout en mettant en avant une nouvelle fois la psychologie de combattants, il parle du ressenti des hommes.
Le régiment participe à une attaque : Dorgelès part de la montée en ligne au retour à l’arrière. Par « attaque », il ne faut pas voir seulement le fait de sortir de la tranchée ; il y a aussi la course dans le no man’s land, la conquête et tenir le terrain pris.
Dorgelès développe beaucoup le « avant ». Certaines phrases sont de simples descriptions, qui, bien que rédigées sur un ton neutre, nous mettent face à l’horreur, déjà. La course, la conquête, il n’en parle pratiquement pas. Il développe par contre l’attente sur le terrain conquis, sous le feu ennemi et les bombardements. L’attente du renfort en apparence montre plutôt l’attente de la mort. Il décrit ce qu’il voit de son trou, dans son trou ; la déshumanisation, le chacun pour soi. Des pages intenses dont les lignes nous font partager le sort des hommes pendant quelques minutes. Pour un calvaire qui dura dix jours. Voilà le prix à payer pour une « victoire » dans le communiqué quotidien.
Le retour est tout aussi instructif car il fait apparaître un élément peu évoqué : le retour à l’arrière. L’abattement moral et physique est palpable. Mais Dorgelès nous montre aussi le ressort moral qui existait. Les hommes arrivent à montrer aux civils, aux officiers supérieurs, une façade qui ne laisse rien voir de leurs souffrances. On perçoit les sentiments, la fierté d’en être revenus qui pouvait les animer.
Comme dans d’autres cas – je pense en particulier à l’article rédigé par Stéphan Agosto dans le magazine Tranchée2 – le régiment revient où il était avant l’assaut. On voit la douleur des civils qui comprennent. Le régiment défile devant le général avec une fierté qui anime les hommes un temps. Cela nous montre toute la complexité qu’il y a à vouloir interpréter les attitudes des individus : quelle est la part du feint, de la façade, du mimétisme ? sur le retour du 74e RI après un passage à Verdun
XII. Dans le jardin de la mort :
La compagnie est dans un cimetière (probablement celui de Neuville-Saint-Vaast où le 39e RI de Dorgelès fut dans cette situation). Les vivants dans les caveaux, cela ne manque pas de faire réfléchir l’auteur. Les Allemands attaquent, mais plus que sur le combat, c’est sur la mort de Bréal qu’il s’attarde. On y retrouve une fois encore le thème récurrent pour Dorgelès de la trahison de la femme aimée.
XIII. Dans la maison du bouquet blanc :
Au repos, les hommes ont envie de s’amuser. Ils préparent un vin chaud, ils parlent. La discussion porte essentiellement sur les femmes quand Bouffioux déclare avoir trouvé un filon : des femmes dans la maison au bouquet blanc…
XIV. Mots d’Amour :
Deux thèmes se croisent : l’attente et la réception des courriers, puis la corvée de ravitaillement. Demachy attend une lettre de sa femme et se porte volontaire pour la corvée et voir le vaguemestre pour avoir son courrier plus vite.
Dorgelès détaille autant l’importance que pouvaient avoir les lettres que le parcours du retour en ligne et ses contraintes. Malgré l’absence de tirs, le temps, le lieu, tout est éprouvant. La nuit est calme sauf pour les hommes.
XV. En revenant de Montmartre :
Le régiment monte en ligne une nouvelle fois pour une attaque. Les hommes parlent de l’arrière, ceux pour qui ils se battent et de ce monde qui les sépare. Le marmitage allemand puis l’assaut met les hommes face à leur destin individuel une fois encore. Se dessine donc dans ce chapitre le destin des personnages que l’on suit et que l’on voyait vivre depuis le début de l’ouvrage. Ce chapitre est nettement plus littéraire (beaucoup de métaphores par exemple) et Dorgelès imagine clairement certains passages.
XVI. Le retour du héros :
Sulphart passe d’abord par la convalescence puis est réformé avant d’être rendu à la vie civile suite à sa blessure. Il va alors de désillusion en désillusion. Si Dorgelès romance une fois encore, on retrouve des thèmes récurrents tirés de sa propre expérience : les femmes (infidèles), les civils qui ne comprennent rien et ne veulent rien entendre de la réalité de la guerre, les anciens combattants perdus dans une société qui ne peut pas les comprendre.
Les civils sont uniquement intéressés par des récits héroïques, influencés par la propagande. Les douleurs restent enfouies, elles ne sont pas exprimées mais finissent par ressortir parfois, malgré tout, furtivement.
- En guise de conclusion
Les Croix de Bois est-il un récit « pacifiste » ? Pour moi, clairement, ce n’est pas son optique même si c’est la conclusion à laquelle des lecteurs ont pu arriver. Dorgelès veut témoigner, non en racontant son parcours (même si on le voit en filigrane) mais en l’utilisant pour réaliser un récit plaçant le lecteur au milieu de ces combattants. Le lecteur doit ainsi mieux comprendre ces hommes qui ont vécu l’indicible, une expérience qui a marqué leur vie plus qu’aucune autre, incompréhensible pour ceux qui n’ont pas combattu. Certes, le lecteur peut se dire qu’il ne faut plus de guerre après celle-ci, mais ce n’est pas le propos de Dorgelès. Il montre effectivement les souffrances, les destins tragiques, mais aussi le rire, la vie dans un groupe soudé.
Ils doivent vivre avec le fait d’avoir survécu, avec leurs souvenirs, leurs cauchemars, leurs amis perdus, leur jeunesse perdue. Ils ont des souvenirs pour le reste de leur vie, si marquants qu’ils ne peuvent plus parler que de cela, comme des vieillards radotant. Ce qu’ils ont vécu est si fort que même les plus à l’aise en apparence en reviennent différents, le choix de Sulphart qui revient à la vie civile prend tout son sens. Alcool, enfermement, perte des repères (épouse, société).
Alors, oui ce témoignage est romancé, mais il est d’une force et d’une humanité rares et son auteur reprend sa propre expérience. Il écrit à l’aide de ce qu’il a vécu, il ne romance pas pour imaginer, mais pour permettre au lecteur une plus grande immersion encore.
- Pour en savoir plus :
Présentation du livre : DORGELÈS Roland, Je t’écris de la tranchée, Paris, Albin Michel, 2003, 344 pages.
Le complément indispensable des Croix de bois :
- Pour aller plus loin :
L’incontournable thèse de Juliette Sauvage (2022) :
https://theses.hal.science/tel-04052187v1
- Ouali Thabette, “Humanisme et engagement : la première guerre mondiale dans les croix de bois de Roland Dorgelès”, Thèse en Langue et Littérature française, sous la direction de Guy Lavorel, Lyon, Université Jean Moulin, 2011. Accès direct à la thèse. ↩︎
- Agosto Stéphan, « Le 74e RI devant Douaumont, 22-25 mai 1916 (1ère partie) », magazine Tranchée, numéro 6, juillet-septembre 2011, pp. 36-45. ↩︎