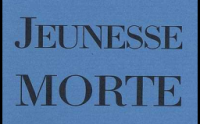GUEHENNO Jean, La Jeunesse morte, Paris, Éditions Claire Paulhan, 2008. 288 pages.
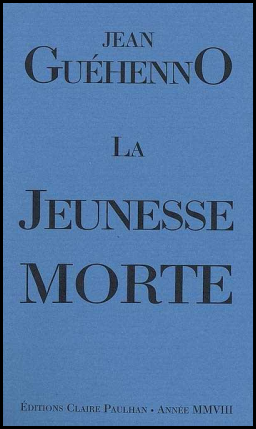
Cet ouvrage n’a pas été publié auparavant car il fut refusé par plusieurs éditeurs dans les années 1920. Il a fait l’objet d’un remarquable travail d’édition expliqué par Jean-Kély Paulhan – aussi auteur de la première préface qui est déjà une analyse du texte – par Philippe Niogret – auteur de la seconde préface, plus historique et permettant une parfaite compréhension du texte – et par les éditions Claire Paulhan (petite-fille de Jean Paulhan qui a écrit un ouvrage sur le conflit qui se démarquait à sa manière des visions plus traditionnelles, comme le fait celui de Guéhenno, mais sous une autre forme).
Cette publication est complétée par des annexes qui prolongent la réflexion (extraits des carnets de Guéhenno, texte rédigé pendant la guerre). Tout est fait pour que le lecteur comprenne l’auteur, le message qu’il a voulu transmettre. On perçoit également à quel point le conflit a marqué de manière indélébile la pensée de cet écrivain.
- Un roman autobiographique
En de nombreux points, ce texte peut faire penser à du Léon Werth. Un roman autobiographique destiné à faire réfléchir le lecteur, la même densité comme dans la série « Clavel », mais Guéhenno est allé plus loin. Les personnages s’inspirent de son expérience et de ses amis. Quand Werth est détaché et désabusé, Guéhenno montre une sensibilité qui le conduit à haïr la guerre.
Ses archives déposées à la BNF ont permis d’en percevoir la précision : on y retrouve de nombreux éléments d’un carnet rédigé en 1914 par exemple. Autre différence avec Werth, visible dès le titre : Werth insiste sur la déshumanisation, sur la guerre elle-même. Guhénno ne s’attache qu’à une idée, montrer à quel point la jeunesse a été inutilement sacrifiée. Il se rapproche alors de l’oeuvre de Vera Brittain au Royaume-Uni, Mémoire de jeunesse.
Les notes de bas de page aident à cerner ce qui est autobiographique et sont donc très utiles. Elles permettent de constater les libertés prises avec la chronologie par exemple.
Mais l’ouvrage est plus qu’une autobiographie : son expérience personnelle est mise au service de sa démonstration.
- Un titre qui a tout son sens
Le chapitre I est un éloge de la jeunesse. Il s’agit d’un autoportrait de Guéhenno. Il vit dans un monde d’idées, où la mort est présente mais sous des formes artistiques, intellectuelles, théoriques. Il montre ce qu’est une mauvaise journée pour lui à cette époque. Page 53, il écrit : « Seul survivait en son âme courbaturée par l’effort une douleur taciturne, croix dressée sur un ossuaire de vies mortes ». Même ce souvenir de l’avant-guerre est douloureux pour lui, malgré, ou peut-être à cause finalement, de son insouciance d’alors, de ses joies, de ses amitiés. En écrivant, il y repense, il a mal.
Ensuite, il définit ce qu’est la jeunesse : « Il avait l’âge encore où l’on espère plus qu’on ne se souvient : le temps passé lui paraissait du temps perdu, le présent le laissait toujours insatisfait ». Il dresse aussi le portrait de l’amitié qui unit ces jeunes hommes, leurs espoirs, en un mot, leur vie. Pages 74-75, il écrit : « J’avais tant d’espoirs autrefois, et voilà que maintenant j’ai peur de mourir sans avoir rien fait. Angoisse impatiente et merveilleuse des jeunes gens, le monde grâce à vous est assuré d’un éternel renouvellement. Vous justifiez la foi en l’avenir. Les vieillards las et trop sages veulent vous attarder et vous retiennent par la manche pour vous conter leurs histoires (…). Votre sourire proteste contre leur grimace, votre fougue contre leur lassitude, et vous courez vers l’avenir comme des baigneurs vers la mer ».
Le chapitre II a pour thème l’amitié, mais il aborde aussi l’avenir prometteur de la jeunesse quand il est écrit « le feu en nous, le feu des idées » page 83. L’auteur continue de dresser sa galerie de portraits, de l’enrichir, de donner de l’épaisseur à chaque personnage dont on sait qu’ils ont un modèle ayant existé : Toudic est Guéhenno, Hardouin est son ami Etévé, Lévy est son ami Durkheim. Ils parlent, ils échangent, il les fait revivre sous sa plume.
Derrière le travail sur la phrase « Une seule chose est nécessaire », encore un souvenir de l’auteur, arrive l’idée de la ferveur qui « ne mène pas bien loin ». N’est-ce pas une critique de cet enthousiasme qui a touché Guéhenno à l’annonce de la guerre ? Est-ce une manière de montrer la fougue de sa jeunesse ? Si la jeunesse est guidée maladroitement pas sa fougue et son inexpérience, on verra un peu plus loin que ses mots les plus durs ne sont pas pour ce qui n’est pas à proprement parler un défaut, mais pour les personnes d’âge plus avancé qui manipulent cette fougue à leur profit.
Il poursuit son travail sur le sujet en développant l’argumentation de Toudic sur « une idée » : celle d’une jeunesse partant à la guerre, sans réfléchir vraiment à ce que c’est, prise dans son élan : « Alors l’idée court une course merveilleuse, fait son profit de toutes choses sur son chemin, des souvenirs qui traînent au fond de l’âme, des agitations du présent, des pressentiments de l’avenir. Tout devient argument. Elle range tout sous son pouvoir, démolit tout ce qui lui fait obstacle, même les puissances établies, marche, grandit, entraîne tout ce qu’il y a devant, autour d’elle et ne s’arrête que pour régner comme un soleil à quoi s’éclaire tout un monde » (page 84).
Cette jeunesse emportée par son élan, joyeuse, heureuse, on la retrouve dans la phrase qui suit : tout est légèreté, pour mieux montrer l’impression de liberté de cette jeunesse qui pense, qui avance : « Des écharpes flottaient dans le vent frais encore, et Toudic y voyait l’image de son âme dénouée et maintenant ouverte à tous les souffles du printemps. Rien de toute la joie de vivre répandue par l’air ne se perdait. Les gais garçons la recueillaient en eux. La vie, leur vie leur semblait belle » (page 76).
Dans le chapitre III, le printemps, saison où tout fleuri , synonyme d’espoir, métaphore de la vie, nous évoque une fois encore cette jeunesse pleine de vie et d’envie. Une image évidemment volontairement forte, qui va créer un contraste très important avec ce que la guerre va en faire. Finalement, c’est déjà une vision de tous ces possibles interrompus qu’il donne. En définissant ce qu’est la jeunesse, il montre ce que la guerre a détruit, fait disparaître : un espoir collectif (la jeunesse), des destins individuels (chaque homme). Ce chapitre est riche en métaphores : un peu plus loin, page 89, toujours autour de la même idée : « Tous ces désirs, tous ces élans, toutes ces paroles, promesses ! La jeunesse de ces hommes passait, semblable à ces ruisseaux des déserts qui, vifs et clairs près de leur source, vont s’asséchant parmi une nature ennemie : ils courent des lieues sous un ciel enflammé et soudain disparaissent, bus par la terre et le soleil, sans connaître jamais sur la mer l’élargissement des horizons. Le pressentiment de leur destin tourmenterait-il ces jeunes gens ? »
Pourquoi autant insister ? Pourquoi revenir sans arrêt sur cette idée que la jeunesse est pleine de promesse ? À n’en pas douter pour mieux montrer le gâchis que fut cette guerre, gâchis individuel et collectif. Mais plus encore car la perte de ses amis est inacceptable pour Guéhenno. Il l’exprime par ses mots, il le crie tout au long de son livre, il veut le faire entendre, que ce gâchis ne soit pas si inutile.
Il finit par égrainer les mois de mai, de juin et de juillet qui précèdent le fatidique août 1914 pour conclure : « La veille de guerre se riait d’eux, attendant pour paraître le soleil d’août ». Il commence alors à développer deux autres thèmes, dont l’un sera récurrent tout au long de l’ouvrage : les fausses idées sur la vision de la guerre de la jeunesse et surtout un plaidoyer contre ceux qu’il appelle « les vieillards » pour lesquels il n’a pas de mots assez durs, les rendant en fait responsables à la fois de la guerre et de tout cette jeunesse morte.
Il ne cache pas son opinion : « Mais le temps de son service militaire est le seul temps perdu dans une vie d’homme du peuple ! L’armée, la grande masse des jeunes gens y pense par force, vers sa vingtième année, et ça l’embête ! La Guerre ? C’est une horreur que, d’elle-même, elle n’entendra jamais et, parce qu’elle ne songe pas à faire la guerre (…). Parce qu’on a reconnu en nous un certain goût de l’action, on imagine que nous rêvons de guerre comme si la guerre était la forme supérieure de l’action ». Et cette idée, pour l’auteur est communément répandue. Pour les « vieillards », page 104 : « que savent-ils, que maintenir le passé, leur passé ? Ils croient ainsi se sauver eux-même, et se défendre contre l’avenir. Car l’avenir est leur mort et notre vie à nous. Ils se défendent vainement contre l’avenir ». Enfin, les trois héros apprennent l’assassinat du 28 juin, plaignant la famille impériale sans deviner l’impact individuel qu’aura ce fait.
Dans le chapitre IV, la jeunesse est mise en avant car c’est elle qui va devoir aller à la guerre. L’auteur réussit à mettre en avant ce rôle vers lequel ils sont « poussés » (et le mot est de l’auteur). Il en parle sans jamais utiliser le champ lexical de la guerre, à l’exception du mot bataille qui pourrait être lié à d’autres thématiques.
Il met en avant la dualité des sentiments qui l’animent : la fierté d’être mis en avant, l’impossibilité de résister à une menace tout de même mortelle. Dans le cabaret où il va habituellement, il perçoit que la situation a changé : il n’entend plus les Allemands. Autrefois, la jeunesse était unie, elle ne l’est déjà plus. La jeunesse ne pense pas, d’elle-même, à se diviser : elle est « une ». Le vocabulaire va dans ce sens : « fraternité humaine », « rencontres fraternelles », « l’amitié des civilisations », « l’unité humaine » sont utilisées pages 108 et 109.
Qui est responsable ? La dénonciation se fait violente contre les diplomates, traités de « cervelles vides ».
Le narrateur écrit avec le recul, il questionne cette jeunesse « bavarde » et aboutit à l’implacable conclusion qu’au bout du chemin, ce sera la mort.
Il développe ensuite sa pensée sur les générations, opposant une fois encore la jeune et la vieille. La Jeune (et la majuscule revient souvent) a l’énergie, mais « Le monde ne marche pas à ton pas, jeunesse ». Il continue : « Naïve qui pensait être née libre, pour toi-même, vivre ta vie, et qui, bonne et généreuse, crois toujours renouveler l’antique terre (…) ». Il est conscient qu’il va devenir vieux lui-même, mais aussi que « peut-être nous mourrons dans l’intervalle, nous mourrons de la pensée des vieux ». Cette pensée, c’est la guerre.
Puis vient le 2 août. Pour montrer la fin de la réflexion et le passage à une situation inhabituelle, Toudic joue un chant patriotique puis la Marseillaise. Il s’intègre dans une forme collective d’hystérie, par un moment décrit comme s’il agissait comme un fou sous le regard d’un de ses camarades. « Jeunesse, on a besoin de ton sang. Et les jeunes hommes par les campagnes, les bras cassés par la stupeur, écoutèrent l’horrible appel ». Sa description d’une scène de rue lui permet de dénoncer la légèreté de cette population et même des hommes qui partent, comme s’il s’agissait d’une randonnée. « On préludait à l’horreur par des farces ».
Dans le chapitre V, la guerre est déclarée, Toudic n’est pas mobilisé. Il s’impatiente, télégraphie à son bureau de recrutement. Il est pris dans une logique qu’il justifie par l’agression allemande : « Il faisait seulement ce que devaient faire, ces jours-là, tous les jeunes hommes de France, occupés à mobiliser leurs souvenirs, à enrôler l’un après l’autre tous leurs sentiments, toutes leurs idées, à se donner toutes les raisons d’être courageux ». (page 170). Les choses ne se font pas naturellement d’après lui : il faut se motiver en pensant à l’enseignement reçu, ce qui a été appris. Tout cela vient de l’école, des souvenirs d’enfance, des lectures. Il met en avant une impression courante, perceptible : « Chacun croyait vivre hors de l’ordre commun, tâchait de se tenir aussi haut que sa nouvelle fortune ». La guerre serait une sorte d’aventure.
Il se retrouve seul, il range ses livres comme on passe à autre chose. Cela le met face aux questions qu’un homme se pose avant de partir : reviendra-t-il ? Pourquoi tout cela ? Il l’écrit à ses amis déjà partis. Mais il finit pas déchirer la lettre : est-il trop tard pour écrire ? Est-il conscient que ses propres pensées de civil ne sont peut-être plus compréhensibles pour ses camarades mobilisés ?
Il écrit sur le lendemain : « Un sentiment est là, très simple, et c’est lui qui fait de nous tous des hommes, l’amour de la vie pour nous-mêmes et en nous-mêmes, pour les autres et dans les autres ». La guerre n’est-elle pas le contraire de cette définition, ou au moins sa mise entre parenthèses ? On tue, on vous tue. (page 128).
Sa réflexion s’achève sur ces dernières phrases : « Il n’eût point sans honte pensé à lui-même : son âme personnelle abdiquait. Il appartenait à la masse, n’était qu’un homme dans le rang, enrôlé dans l’immense troupe de citoyens du monde ».
Le chapitre VI voit Toudic à la caserne. L’auteur aborde alors la question de l’absence. Chacun est seul et se demande ce que deviennent les autres. On pense aux autres, sans imaginer qu’ils puissent être déjà morts. On écrit, on attend des nouvelles. Il évoque alors les courriers reçus de son ami : « Il n’est triste, à mon avis, que de ses souvenirs. Il faut que les camarades morts de ces derniers jours aient en effet sauvé le monde. Les vivants l’affirment entre eux, et je l’espère de toute mon âme. Mais je crains un peu qu’on dise trop de bien de nous. Défaite ou victoire, la bataille est toujours laide » (page 135). Si la victoire est belle, on va encore leur demander de se battre. Or, se battre, ce sont des morts.
« La vie des soldats, triste et monotone, avec ses accès de furieuse démence, monstrueuse, que devint-elle dans l’âme de ceux qui les aimaient ? ». Cette question posée page 136, trouve un début de réponse avec les courriers. Cependant, il montre que ces courriers reçus sont mensongers. Voici sa démonstration : « On attendait les lettres, on les lisait, on les relisait. Elles étaient gentilles, menteuses souvent, afin de ne pas faire souffrir. Les mots en étaient ordinaires, neutres. Celui qui les avait écrite l’avait voulu ainsi, se disant que l’amour les ferait assez vivre, mettrait en eux assez de tourment et de sang. Impuissante, une immense souffrance se taisait. On devinait d’abord en effet, mais l’idée de cette douleur taciturne effrayait bientôt ; on préférait croire la lettre sincère : « Il ne se plaint pas, disait-on, il ne se plaint jamais… » On recommençait à douter quelques fois : « Si pourtant… », mais on attendait une prochaine lettre pour décider ».
Ainsi, Toudic se contente à la réception des lettres de se dire : « Ils étaient vivants ! Qu’importait le reste ! Qu’importait comme ils vivaient ! Puisqu’ils vivaient ».
Il termine son chapitre en mettant en avant le décalage qui s’installe très vite entre la vision de la guerre de l’arrière, piège dans lequel il tombe lui-même, et la réalité des combattants. Pour illustrer ce décalage, il écrit page 138 à propos toujours de la victoire de la Marne : « Quand vinrent les grands jours de septembre, Toudic s’étonna encore que les lettres de ses amis fussent si prudentes. C’était son idée que la victoire crie et chante, alerte, fraîche et joyeuse, soldats brandissant dans les herbes et sautant les haies, les pans de la capote au vent, courant et reprenant haleine dans leur course, reconquérant leurs terres et sauvant la Justice ». Il conclut page 140 : « C’est ainsi que l’on commençait à écrire deux histoires. Les armées à l’assaut écrivaient l’une, de sang et de résignation. L’arrière écrivait l’autre. Elle n’était pas la moins héroïque. Il ne lui manquait que la connaissance et la pitié ».
Pour l’auteur, la victoire est un mythe, aussi vieux que l’homme. Mais de victoire, il n’y a point puisqu’on la cherche depuis la nuit des temps. On est donc esclave de cette idée, et finalement, il utilise une métaphore très dure pour en parler : la victoire est une prostituée, elle se vend au plus fort, avant d’aller voir le suivant. La satisfaction de gagner est de courte durée et il faut en payer le prix.
Le chapitre VII s’ouvre sur la reprise de ses réflexions (et ses attaques) contre les motifs donnés pour justifier cette guerre. Ces motifs font qu’on envoie régulièrement des renforts vers le front, oubliant que renfort veut dire comblement des pertes. Le front est vu comme une « bête de proie » que l’on nourrit sans réfléchir car la manipulation (il parle de mensonge page 142) des « vieillards » est en route. « En la guerre des tranchées périssait une Jeunesse. En la guerre des chancelleries et des politiques, une imbécile fatuité trouvait son triomphe. Mais ceci compensait cela. » Plus généralement, c’est un aveuglement collectif qu’il dénonce par une périphrase : « Car tout se mit à mentir : les faiseurs de discours, les journalistes et les artistes et les savants eux-mêmes. Et naïvement, et honnêtement encore sans doute ». Mentir honnêtement, ou comment dénoncer cet aveuglement ; mais il pousse sa réflexion plus loin pour dénoncer ce qu’il juge sot : on veut venger les morts en faisant de nouveaux morts ! Les discours sont balayés par la réalité, même à l’arrière : liste des morts dans les journaux, femmes portant le deuil… « Dans les rues on se montrait des femmes en deuil, les premières de cet innombrable cortège noir qui te suit toujours, victoire radieuse ».
Quelques scènes de caserne lui permettent d’aborder d’autres thèmes : l’individualisme qui pousse les anciens à espérer que les jeunes partent les premiers (encore un point commun avec Léon Werth) ; la distribution des lettres qui voit Toudic apprendre la mort de son ami Lévy. Il imagine « Parmi les annonces commerciale à la suite des nouvelles, ces trois lignes : « Jean-Marc Lévy, mort au champ d’honneur, à l’âge de vingt-six ans ». Et ce serait la dernière trace de son ami dans le monde. Ce serait fini, fini d’aimer, fini d’espérer, fini de faire des choses. Une femme qui l’aimait continuerait seulement à souffrir à cause de lui. Un petit grandirait pour qui il ne serait qu’une photographie ou un être de légende (…). Ainsi dépêchait-on les jeunes hommes morts vers le grand silence avec un doigt d’eau bénite et trois mots de louanges », page 151.
Les promenades à la sortie des usines où il rencontre des jeunes femmes ; sa théorie morale avant le départ. Enfin vient le départ en Belgique, les 36 heures de train, la première montée en ligne, sa découverte du front page 176 : « La bête respirait. Le ciel s’illumina comme pour une fête. Il était au milieu d’un cercle de feu. Des fusées tout autour de lui montaient. Des machines faisaient de grands battements d’ombre et de lumière, comme si la bête détendait ses anneaux, faisait jaillir des étincelles ».
Dans le chapitre X, il résume son expérience ainsi, page 179 : « Pendant des mois, Toudic et Hardouin (…) vécurent dans la même horreur ». Il décrit en partant de ce qu’il voit des photographies aériennes, les réseaux de tranchées, « sentiers humains ». « Pourtant ce fut dans ce cadre inhumain, sur ce fond de désastre et de crime, que l’on dut dresser une stature d’homme » : il exprime là la complexité de la situation. Loin de « l’union sacrée » imaginée, Guéhenno insiste, page 186 : « Non qu’une armée fut un seul cœur, une grande amitié. On y reconnaissait toutes sortes de divisions, d’une arme à une autre arme, d’une compagnie à une autre compagnie, même d’une escouade à une autre escouade. Hardouin pouvait écrire « qu’un soldat avait quelquefois plus de haine pour tel autre soldat, ou pour tel caporal, tel lieutenant, tel général, qu’il n’en avait pour tous les Allemands » et la nécessité assurait seule la cohésion de ces dissentiments ».
Même avec son ami, les points de vue divergeaient. Toudic est torturé par ce qu’il vit, ce qu’il voit. Il ne s’y habitue pas. Il est choqué quand ses camarades regardent avec joie les Minen tomber sur les voisins : « Ma vie m’est-elle plus chère que la vie de mon ami ? ». Il poursuit sur cette vision de l’individualisme, à un autre niveau : « De leur mort, ils voudraient qu’on soit inconsolable ; pour notre mort, ils ont des consolations toutes prêtes. Meurent-ils, c’est une apocalypse. Mourons-nous, c’est une apothéose ».
Le chapitre XI place Toudic dans son escouade. Il n’a de relation amicale qu’avec « le Noiraud », homme simple et de bons conseils. Il explique que bien que toujours prêt à rendre des services, le reste de l’escouade se méfie de lui car il pense trop. « Il se rongeait ». Il ne cesse de s’interroger :, « Que valait cette passivité, cet asservissement à une œuvre de mort . Et que faisaient-ils dans cette foule ? Ah ! Ils étaient déchus de leur qualité d’homme, si être un homme, c’est penser et vouloir et faire consciemment ce qu’on veut faire ! ». Et il continue, toujours page 199 : « Les jours d’attaque étaient des jours de crise. Alors on les voyait courir des courses hallucinées et leur âme affranchie des lois ordinaires de l’être, se hausser par delà le bien et le mal et se perdre et mourir ou bien retomber à un assouplissement vide, comme ces vagues qui semblent parfois escalader les falaises, déferlent et ne sont plus bientôt qu’une eau plate qui s’écoule doucement entre les roches ».
Ses réflexions se tournent vers la mort au combat et la souffrance : « Chacun pensait survivre, et que la brute en lui suffirait à porter le mal, si longtemps qu’il durât ». Le suicide d’un camarade nourrit ses pensées.
« Sans doute il n’y avait pas de religion de la souffrance et des martyrs n’étaient pas toujours des saints. Sans doute, pas plus que cet enthousiasme de roman, leur réelle souffrance ne suffisait pas à faire d’eux des héros ». Malgré toutes ces souffrances, les hommes tiennent car ils ne réfléchissent plus, comme les personnes qui les dirigent. Ainsi, à part un suicidé et un homme devenu fou, tous tiennent : « Le courage des hommes dans la tranchée n’était pas non plus une pose fanfaronne. La vérité était plus simple. Les hommes étaient soldats comme ils avaient été ouvriers ou paysans. Leur courage était le courage quotidien du métier. (…) Ils subissaient la guerre comme ils avaient subi la misère (…). Les hommes du commun avaient sur tous les hommes cultivés comme lui-même, cette supériorité infinie, que jamais, ni les idées, ni la civilisation ne leur faisaient perdre de vue l’homme ». Page 207.
L’auteur aborde l’attaque du 25 septembre 1915 dans son chapitre XII. Il commence par une métaphore, les combattants sont sous un orage. Mais il défait très vite la métaphore pour revenir à la réalité : le tonnerre n’est rien à côté de ce « déluge de fer et de feu ». Il poursuit avec une nouvelle figure de style, confrontant des mots opposés : « On était oppressé de tendresse et on se voulait cruel. La peur était à côté de l’audace. La foule entière voulait vivre et chacun s’apprêtait à mourir ». Pour montrer le caractère utopique d’une éventuelle victoire, il utilise une nouvelle figure de style : « On allait s’emparer de tout l’horizon, et la guerre serait finie, serait tuée ».
L’avance en Champagne est réelle pour Hardouin, elle ne l’est guère pour Toudic à Souchez. Il conclut : « Pauvre belle chair humaine, aimante, aimée ; il y a vingt ans, chair de petits enfants avec des fossettes pour les baisers des mères, maintenant chair de jeunes gens, chair de joie, luisant et ferme, faite pour toutes les entreprises, ce fut l’un des jours de ton supplice. Combien ce jour-là tombèrent qui n’étaient point las ! ».
Toudic est blessé. Il voudrait ne pas se souvenir car il a tué mais cela restera en lui, indélébile. Il arrive au poste de secours. Il y retrouve Noiraud qui est touché à la tête et semble avoir perdu conscience de ce qui l’entoure. Il évoque la foi, l’animalisation (les hommes ont des plaques d’identité comme les chiens, « chiens armés » pour parler des hommes). L’agonie de son ami est pour lui l’occasion de réfléchir sur la liberté, sur cette jeunesse qui monte au front devant le poste de secours. Il parle de « fleurs d’homme » pour ces jeunes. Les « vieillards » n’y sont pas.
Il finit par montrer toute la richesse de la vie qui disparaît, et de penser à tous les autres. A un moment où leur vie, leur âme n’a plus de valeur, n’a plus rien de sacré.
Dans le chapitre XIII, on découvre que Toudic a perdu l’usage de son bras gauche. Non sans ironie, il garde son bras, il repart joyeux comme un enfant : c’est dire la souffrance qu’était pour lui sa présence au front. Plutôt mutilé que là-bas ! C’est ce qu’il se dit dans un premier temps, avant d’avoir mauvaise conscience : la jeunesse y est toujours. Il a connu l’enfer, il redécouvre le plaisir de flâner (il décrit un parc, la campagne, les couleurs, les essences). Mais ce plaisir de vivre n’est qu’une illusion : la mort se rappelle à lui par l’absence de nouvelles d’Hardouin. Il reçoit enfin une lettre, mais qui est en fait un testament. On comprend que son ami est mort. Plus qu’un testament, Guéhenno en fait un véritable plaidoyer pour la jeunesse.
D’abord, c’est un refus : celui d’utiliser la mort pour justifier des discours : la mort de cette jeunesse n’est pas acceptable, elle n’est pas enviable et elle n’est pas héroïque. Par l’ironie, il veut détruire tout essai de dire que ce fut une belle mort, une mort utile : « Et c’est vrai que nous aurions tort de nous plaindre, nous autres les morts. Nous ne verrons plus la beauté du monde, la mer infinie, la bonne terre, les cieux illuminés de noirs », page 232.
Toutes les célébrations sont rendues illégitimes : religieuses, scolaires, « sur les tombeaux les épitaphes consolantes (…) l’oubli de l’horreur et l’exploitation des morts ». Pour lui, et il utilise l’expression, la paix doit être la guerre à la guerre. « Dis seulement aux vieillards de ne point chanter ma mort. Elle ne fut point volontaire. Je ne suis pas mort sans lutte. On se laisse arracher à la vie, on ne l’offre pas » (pages 234-235) et continue sur cette idée un peu plus loin : « Tu leur diras que ce ne fut pas facile de mourir. Peut-être quelques jeunes bravaches meurent-ils aisément ». Et par un retour des valeurs, c’est le jeune qui devient sage et donne des conseils aux anciens : « Tu leur diras, à tous les vivants, de repaître de toutes les choses éphémères, de savourer la vie et de l’aimer si fort, qu’ils finissent pas la révérer en autrui comme en eux-mêmes » (page 235-236).
Il a cette phrase prophétique : « La consolation est le commencement de l’oubli et souvent le prélude de nouvelles faiblesses (…). Que dans vingt ans on nous regrette assez pour que le crime ne se renouvelle pas ». Il termine par cette phrase plus personnelle : « Tu sais bien que je ne serai pas mort tout à fait tant que tu vivras ».
Le chapitre XIV montre à quel point il a beaucoup perdu avec cette guerre. Il ne sait plus comment se définir : esclave ou « esprit maître de l’absolu » ? Il a perdu en même temps ses illusions, sa foi dans les penseurs et surtout « Il est seul » écrit-il page 244. « Son monde à lui est détruit, disparu en même temps que les deux ou trois êtres qu’il avait aimés ». Finalement, il s’interroge « Pourquoi eut-il le privilège de survivre au désastre de sa génération ? ». Probablement est-ce ce questionnement qui l’a poussé à donner du sens à cette survie : témoigner, à sa façon, dire son amour de la jeunesse, de ses amis pour que ce gâchis ait au moins eu cette utilité, vu qu’il ne croit pas en la victoire, en la paix. Cette fin est finalement le début de la concrétisation de sa démarche, de cette réflexion menée depuis les tranchées.
Je reprends une dernière fois les mots de Jean Guéhenno tant ils sont plus efficaces que de longs discours, à la fois pour parler de ce livre mais aussi pour comprendre son état d’esprit « Ce que les jours de misères bâtissaient n’étaient ni la victoire des uns, ni la défaite des autres. Parmi les morts, on ne distingue ni vainqueurs ni vaincus. Tous les morts sont des morts. Un seul fait domine tous les autres ; la vérité, cet l’immense cadavre de la jeunesse étendue en travers des plaines de l’Europe. (…) La jeunesse morte fut comme un rédempteur innombrable. Elle eut conscience, comme l’autre rédempteur, de la passion honteuse qu’elle souffrait et la souffrit pourtant par la certitude qu’elle avait d »instituer au cœur du monde le respect de l’homme ». Page 249.
En guise de conclusion :
Un ouvrage d’une grande richesse littéraire qui pose des questions complexes, qui tente de prendre du recul sur les conséquences de cette guerre, comme sur ses causes. Littéraire car utilisant de nombreuses figures de style, organisant les premiers chapitres de manières identiques (une phrase sur le temps, un long développement sur le thème ou la situation de départ sous forme d’une description de la situation, des pensées du héros ; finalement, les dialogues avec les personnages sont le dernier mouvement de l’ensemble. Les remarques des héros complètent et précisent les réflexions initiales).
Cette jeunesse morte est pacifiste mais en essayant de faire réfléchir le lecteur. La partie sur la souffrance de ces jeunes est la moins développée : il a accepté cette souffrance, il a perdu un bras, mais ce qui est le pire dans tout cela, c’est bien la perte de ses mais, symboles de cette jeunesse. L’auteur essaie d’appuyer sa démonstration sur la vie d’avant-guerre essentiellement, mais aussi sur ce que chaque disparition voit s’effacer comme espérance, comme devenir. Il combat aussi les lieux communs utilisés pour justifier ces sacrifices, ou permettant aux civils de les accepter alors qu’ils sont, aux yeux de l’auteur, totalement inacceptables, injustifiables. Même si l’auteur est conscient qu’il a un point de vue différent, si son individualité fait tache jusque dans son escouade, s’il écrit son point de vue, son œuvre mérite d’être découverte car il porte un regard très riche sur la société et les mentalités de l’époque. Il permet au lecteur de l’éclairer d’un regard différent, philosophique, et le pousse vraiment à réfléchir, à se poser de nombreuses questions sur la diversité des points de vue dès 1914.
L’intérêt de cette construction est de faire que le récit ne soit pas simplement un essai philosophique mais aussi une histoire très humaine. Cet effet est accentué par l’impression d’avoir une présentation avant de voir les personnages évoluer et par la richesse des sentiments et des qualificatifs utilisés. On voit les hommes débattre, réagir tant les descriptions sont fines.
Un roman autobiographique clairement au service d’une démonstration où les libertés prises avec la chronologie des faits ne posent pas de problèmes. En effet, Guéhenno évoque peu son parcours dans la guerre mais essaie de tirer des réflexions des grandes étapes traversées : l’avant-guerre, la mobilisation, les débuts sous l’uniforme, au front, la blessure, l’après. Il veut montrer que la jeunesse a été sacrifiée au service de générations et d’idées surannées. Sacrifice injustifié et injustifiable, sauf si cela permettait de ne plus avoir à sacrifier une nouvelle génération. Plus encore qu’un livre philosophique ou un livre appelant à la paix, cet ouvrage est un cri. Un cri pour cette jeunesse disparue, un cri d’amour à ses amis.
- Pour trouver l’ouvrage :
https://www.clairepaulhan.com/catalogue/p/la-jeunesse-morte-jean-guehenno