VILDRAC Charles, Souvenirs militaires de la Grande Guerre, Paris, Éditions Claire Paulhan, 2021, 288 pages.
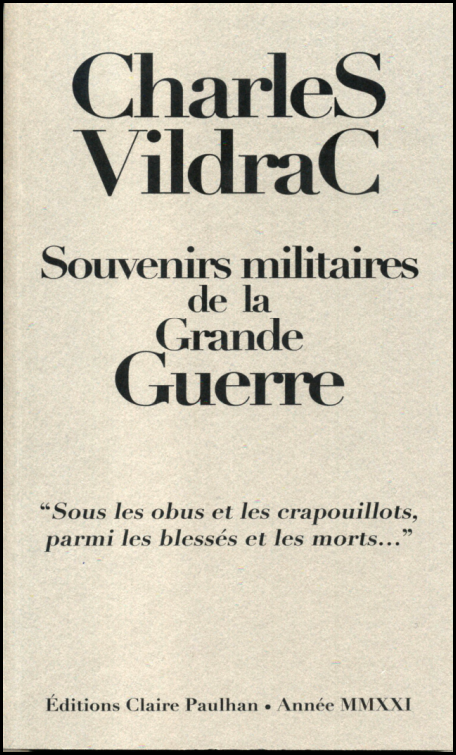
Charles Vildrac (1882-1971) est un auteur connu pour ses écrits pour enfants et sa poésie. D’ailleurs, son lien avec la Grande Guerre, avant ces souvenirs, peut être découvert dans un recueil de poésies publié en 1920, « Chants du désespéré » puis en 1927 dans une version plus riche.
J’ai souvent dit tout le bien que je pensais de la maison d’édition « C’est-à-dire éditions ». Je n’aurais de cesse de faire l’éloge également des éditions Claire Paulhan.
Lire un témoignage, c’est non seulement vouloir découvrir les éléments factuels proposés par l’auteur, c’est aussi vouloir comprendre les choix de celui qui écrit, ses sensibilités, son vécu. Or, dans nombre d’éditions de témoignages ou de correspondance, l’éditeur fournit trop peu sur l’auteur pour comprendre correctement son point de vue. Pire, dans certains cas, il n’y a aucun élément biographique. Trop souvent, l’introduction est une analyse du texte qui donne tous les temps forts avant lecture !
Ici, le lecteur découvre une biographie très complète de Charles Messager dit Vildrac, ses origines familiales, ses études, ses activités, ses relations amicales et professionnelles, et évidemment ses passions. Ce dernier élément est d’autant plus important car il permet de comprendre la sensibilité des mots de l’auteur, sa vision particulière du conflit.
Riche en illustrations, complet concernant la carrière artistique de Charles Vildrac, le lecteur est bien accompagné dans sa lecture par des notes explicatives concernant l’histoire du manuscrit jusqu’à sa publication finale en 2021. Se trouve dans ces explications le seul regret concernant cette édition : on y apprend qu’il existait un premier chapitre concernant son service actif au 46e RI de Fontainebleau en 1903-1904. Je regrette vivement le choix de ne pas l’avoir inclus, tant sa vision pouvait être intéressante, non seulement en raison de ses opinions personnelles mais aussi simplement parce que ce sont des témoignages rares.
J’ai noté une erreur dans l’introduction, page 11, concernant son parcours militaire : les deux périodes de réserviste ne sont pas de 28 jours chacune. Surtout, c’est au cours de la première période qu’il participa aux manœuvres et non la seconde, plus courte et en juin.
Les photographies sont aussi un autre point qui nécessite quelques précisions. Les photographies de Vildrac sont relativement nombreuses, mais leur utilisation dans le livre est peu respectueuse de la chronologie. Pour illustrer septembre 1914, une image avec des casques prise vers 1916, ça ne va pas. La plus ancienne est celle où l’on voit trois hommes dans la gaize de Vauquois1. Bien que cet abri soit décrit dans le texte, l’image n’est pas reliée au texte. Tous les autres clichés montrent des hommes casqués et sont donc postérieurs à octobre 1915, mais sont utilisés pour la période qui précède cette date.
- Un témoignage après coup
Ce témoignage est une reconstruction ultérieure. Il propose un regard rétrospectif et introspectif. Il offre quelques réflexions et méditations autour de sa guerre. Ce n’est pas celle d’un jeune fantassin de l’armée d’active, mais celle d’un réserviste de la classe 1902, déjà âgé de plus de 30 ans mais pas encore de la classe d’âge des territoriaux. Cela aura son importance dans son parcours et explique son sentiment page 96 : « je me sentais arraché à moi-même, détourné de ma route, livré une fois de plus à la discrétion et à l’autorité absolue des ordonnateurs de la tuerie ». Plus loin, il précise au moment de son passage au dépôt après un premier séjour au front : « Je nous sentais réduits à l’état de matériel humain où nos maîtres faisaient selon les besoins de leur échiquier sanglant. Il y avait en effet à intervalles irréguliers des départs plus ou moins importants. Les hommes qui n’avaient pas encore connu le front, pouvaient montrer ce consentement ou cette résignation, ce conformisme dans le sentiment de devoir, cette curiosité, voire ce prurit chauvin qui, aux jours de la mobilisation, remplissait les trains de clameurs guerrières. Mais ceux qui venaient de faire une première expérience des combats (…) se sentaient accablés par l’adversité. Les plus malins, les plus avisés tentaient d’y échapper ». Des thèmes qui seront développés dans cet article transparaissent ici : la critique des généraux qui déshumanisent leurs hommes, les tentatives d’embusquage et évidemment, la mort qui est tue bien que présente partout.
Il offre donc une narration ponctuée d’anecdotes précises et d’impressions plus qu’un récit factuel chronologique. Certes, il suit les étapes de son parcours, mais il ne propose pas un texte quotidien. Il est même parfois difficile de comprendre la date de ce qui est raconté. Seuls les événements dont il se fait l’écho permettent de le déterminer avec précision. Il y a évidemment les notes de bas de page, mais elles se concentrent sur des éléments un peu trop généraux, que ce soit concernant les événements relatés ou les personnes citées. Ainsi, les combats de la Marne évoquent plus la bataille en général que les combats du 46e RI quand les biographies ne s’attardent pas sur l’affectation des personnes. « Paul, avec son Vérascope, photographie l’énorme tronc d’arbre qui, seul, se dressait encore sur la Butte, non loin de la crête, absolument amputé de toutes ses branches » page 125 fait l’objet d’une note qui explique le principe du Vérascope, mais passe sous silence l’anecdote atour de ce fameux tronc.
- Les écrits de Charles Vildrac en unité combattante (1914-1915)
Charles Vildrac a recomposé un récit de sa mobilisation puis de son arrivée au front. Il est du premier renfort envoyé au 46e RI fin août 1914. De nombreux indices permettent de le confirmer même s’il ne donne pas de dates précises.
L’évocation de son baptême du feu nous plonge dans l’incompréhension dans laquelle étaient les hommes. Où allaient-ils ? Pourquoi ? Ils ne savent rien, obéissent, sont sous les feux allemands. On retrouve l’errance après le combat, l’épuisement, les retrouvailles avec la compagnie. Il focalise ses souvenirs sur une impression et la mort de son cousin tout juste retrouvé. Il est l’un des rares à évoquer la question des disparus et l’espoir qui était lié à ce statut particulier :
« Jusqu’à la fin de la guerre, il fut, comme tant d’autres, porté disparu. Lorsque j’écrivis à mon oncle, son père, que j’avais vu tomber Fernand, frappé d’une balle dans la bouche, il me répondit que son fils n’était pas mort, mais disparu ; la formule disparu, appliquée à tous les morts dont la plaque d’identité n’avait pas encore été retrouvée, entretint dans maintes familles un espoir tenace », page 59. Jugement du 7 mai 1920 transcrit le 14 juin 1920 au 5e arrondissement de Paris.
La suite de son récit de début de guerre est tout aussi passionnante : l’auteur suit son régiment dans des marches et des repos dont il ne comprend toujours ni la raison ni les finalités. Il résume la situation par une métaphore page 63 : « Le pion qu’on déplace sur l’échiquier ignore ce qu’on attend de lui ». En le suivant, il évoque une ou plusieurs anecdotes sur ses camarades, ce qui montre l’écriture profondément humaniste de l’auteur : entre ses impressions, ses observations l’humain est toujours très présent. D’autant que les notes de bas de page permettent de comprendre que la majorité des noms qu’il mentionne sont soit des personnes aux sensibilités artistiques, soit des hommes tués au cours du conflit.
Dans les premières semaines, Vildrac ne cesse de mentionner les « rapines ». Les soldats français comme allemands cherchent à se ravitailler, dans les vergers, les jardins abandonnés ou en achetant à vils prix ce que des habitants acceptent de leur céder.
Dans « Boureuilles », il narre la technique de quelques traînards pour retarder le retour à la compagnie. C’est la période où les marches disloquent les unités. Mais à la mi-septembre 1914, la première période au front de Vildrac prend fin après que son groupe ait tenu trois jours une position coupée du reste du régiment. Il y développe une entérite qui conduit à son évacuation.
Il détaille le trajet du train qui l’amène à Pézenas où il reste un mois. Les anecdotes sont encore nombreuses, levant un voile sur cette expérience particulière. Il en est de même pour le passage suivant, au dépôt du 46e RI où les vétérans sont séparés des nouvelles recrues.
Il cherche clairement à freiner son retour en unité combattante au front. Il échoue à dissuader son ami Henri Doucet de s’engager volontairement. Il se fit tuer dès son premier jour au front en janvier 1915.
Il détaille les stratégies utilisées avec son ami Déchamps pour faire le mur afin de passer du temps avec sa femme. On suit le jour où il est pris par un contre-appel et écope de huit jours de salle de police. Il ne manque pas de faire référence à la littérature militaire d’avant-guerre page 96 : « De telles frasques, dont nous étions coutumiers, semblaient renouvelées de Tire-au-Flanc ou des Gaîtés de l’Escadron ». Il en profite ensuite pour se justifier. Il explique cette audace non par un esprit « frivole » mais par le fait que ces « morts en sursis » pouvaient, dans certains cas, suivre le fameux « Carpe Diem ». Il conclut « J’ai pu le constater au front de même, dans les heures calmes et les jours de repos ».
À la mi-janvier 1915, l’ami de Vildrac, Déchamps, le quitte pour être automobiliste dans une formation sanitaire. À la mi-février 1915, Vildrac rejoint le front après son nouvel ami, Paul Villé. Mais il retourne dans un des secteurs les plus durs à cette période : Vauquois.
Une fois encore, la narration est très complète : on le suit dans son trajet de retour au front. Il ne manque pas d’évoquer la journée passée à dessiner pour un enfant avant son retour en unité combattante. Il réussit à être affecté dans l’escouade de son ami Villé. S’enchaînent alors les entraînements en vue de l’attaque de la crête de Vauquois.
Après l’avoir entendu dire qu’il prendrait Vauquois « Ça me coûtera ce que ça me coûtera », Vildrac se montre très critique contre Sarrail et plus généralement contre tous les généraux. Plus loin, page 103, il revient sur cette phrase « Pour des personnages d’un certain rang, l’une ou l’autre cause [disgrâce ou considération] ont presque toujours le même effet », à savoir la mort des soldats. Et il conclut après l’échec de la prise de Vauquois : « Combien y en avait-il déjà, depuis la veille, de morts comme celui-là, victimes de la prodigalité sanglante d’un général résolu à s’offrir un brillant communiqué sans regarder à la dépense ? », page 116.
Le récit de l’attaque de Vauquois du 28 février 1915 nous plonge au cœur d’un combat, mais surtout du maelstrom ressenti par les hommes. L’auteur l’analyse des décennies plus tard et y complète sa critique des généraux : les situations ineptes, l’absence de décision, les lacunes de commandement qui s’enchaînent, le tout laissant une désagréable impression d’amateurisme coûteux en vies humaines.
Les troupes devant partir à l’assaut arrivent de nuit à flanc de colline, d’où ils se font abattre au petit jour. La préparation d’artillerie est courte, imprécise et ne fait pas taire les batteries d’artillerie et de mitrailleuses du bois de Cheppy qui arrosent de flanc la zone d’attaque française. Pire, une fois les troupes au bord du village, les canons de 75 français tirent sur la zone capturée et obligent les attaquants à refluer vers la ligne de départ. Vildrac perd son ami Adler, d’abord blessé par un moellon et achevé par des tirs d’artillerie.
La déshumanisation de la décision d’attaquer n’est pas la seule évoquée. Vildrac évoque l’horreur de ne pas réussir à dégager un blessé d’une tranchée, en partie en raison d’un adjudant menaçant, puis de constater que le blessé est resté sur place et a fini englouti dans la boue, servant de chemin « dur » pour les soldats de passage. La mort, la peur, le découragement et la sidération sont autant de thèmes abordés dans ce récit de quelques jours. On est très loin des récits de propagande qui ne manquent pas de mettre en avant la présence de la musique du régiment qui joue pendant le premier assaut, ce que mentionne aussi Vildrac mais pour en rappeler le coût humain.
Au bout de 48 heures, Charles Vildrac décrit son état d’abattement : il ne se lève plus pour tirer lors d’une alerte, il dort sur le sol. La relève n’arrive que le 4 mars non sans avoir dû monter une dernière fois sur la crête pour une corvée, retrouvant le lieu où leur camarade avait été tué mais où tout était bouleversé. Au retour, l’escouade n’a plus que quatre hommes. Il évoque alors le retour à la vie, malgré tout.
Dans « Alternances », page 119, il décrit l’après assaut, le plaisir de retrouver les effets qui rappellent qui on est, ici une édition des Illuminations de Rimbaud. La vie qui reprend, le calme, le courrier, mais aussi les absents. Il réfléchit, il observe l’amoindrissement de ses capacités dès le deuxième jour de combat, sur les urines foncées voire sanglantes. On juge la qualité des officiers, du capitaine courageux au médecin-major peu apprécié, une « brute féroce » qui photographie et qui part du principe que tous les hommes sont des simulateurs.
Face aux pertes, on cherche des gradés. Il refuse de devenir caporal car « C’eût été m’engager à exécuter ou faire exécuter des ordres absurdes ou révoltants pour la conscience comme pour le sens commun », page 120.
L’arrivée d’un contingent du 58e RI en renfort, 120 sont affectés à la compagnie de Charles Vildrac. Il termine cette période par une prise d’armes pour la distribution de quelques décorations, dont une à un sergent des cuisines très peu apprécié. Ensuite, c’est le retour en ligne à Vauquois.
Les anecdotes continuent. Paul et Charles « adoptent » un nouveau camarade, Bonvalet. Ils s’abritent encore dans un trou dans la gaize, « transis de froid, imprégnés de l’humidité de la guerre et des pierres fraîchement remuées ». Après un repos de quatre jours, retour une nouvelle fois à Vauquois, mais cette fois-ci dans un abri comportant un cadavre allemand. Désormais s’ajoutent les tirs de mortiers.
Il évoque les différents lieux de ce secteur : Bois-Noir, Mamelon-Blanc, mais aussi les villages de l’arrière. C’est à cet endroit qu’il apprend la mort de son ami Henri Doucet.
Charles Vildrac ne cache pas qu’il cherche un filon pour quitter l’unité combattante. Son ami Paul en obtient un et continue de venir le voir fréquemment avant de lui obtenir un poste de brancardier.
- Brancardier à Vauquois (1915-1916)
On entre alors dans le quotidien d’une équipe de brancardiers. Isolés du reste des unités, il explique d’abord l’organisation : trois groupes de quatre brancardiers, un caporal brancardier et un caporal infirmier. Comme le baptême du feu, Vildrac se souvient parfaitement de son premier blessé. Il ne cache pas la difficulté morale et physique de la fonction, mais l’expérience se fait peu à peu. Il décrit les lieux de vie du groupe, la vie avec ses nouveaux camarades. Il montre toujours une grande empathie, un amour réel de son prochain. Il met de l’humanité dans ces portraits et montre la diversité des parcours de ces hommes réunis fortuitement et temporairement en raison de la guerre.
Il revient sur le repos page 138 et apporte au lecteur des éléments de compréhension sur le relâchement qui suit la relève de première ligne : « Une fois de plus, la mort avait été pour d’autres, pas pour eux. Ils croyaient à leur chance, souvent miraculeuse et lui faisaient confiance. J’ai éprouvé cela. »
« Martyrs et forçats » Ici, Vildrac n’est plus poète, il est un brancardier devant faire face à l’horreur de la blessure. Il admet s’être rapidement adapté physiquement et moralement mais il précise : « c’est au sortir de la guerre que j’ai subi la hantise de tout ce que j’avais vu et vécu. J’en garde encore aujourd’hui le souvenir intact et ineffaçable » page 146. Suit une série d’anecdotes autour des blessures, des différentes réactions des blessés dont celle d’une bagarre entre un capitaine du génie et un de ses soldats, qui ne se termine pas en conseil de guerre. Il n’oublie pas de raconter des terribles histoires des mineurs de Vauquois.
Parmi les missions, il faut aller chercher les cadavres tués lors de précédents combats. Il raconte le récit de la découverte du corps de Beaufils et comment il l’annonce à son épouse qui ne veut pas le croire. Il finit par être témoin pour l’acte de décès de son ami.
Il poursuit au fil de la chronologie la série de portraits des hommes qui accompagnent, souvent temporairement, son parcours. Dans « Récréation », il fait la présentation d’un nouvel ami, Rouchaud, violoniste à la musique du régiment. Il trouve un ami fidèle pour parler poésie et musique au cours de balades. Dans « Fairise », il évoque un lieutenant apprécié, parlant le russe et ayant une quinzaine d’engagés volontaires russes sous ses ordres. Un autre russe entre dans l’histoire : Rousky, médecin. Bonvalet a rejoint Vildrac mais il perd Boichot, blessé. Le tout se termine par la mort révoltante de Fairise.
Finalement, il accepte de devenir caporal brancardier suite à l’évacuation du précédent vers août 1915. Il n’a pas à donner d’ordres contraires à ses valeurs ou aberrants, juste à diriger des équipes de brancardiers.
Il critique un ordre indiquant qu’il n’y avait pas assez de pertes, l’envoi de territoriaux pour des missions auxquelles ils n’étaient pas préparés, l’essai des pompiers de Paris avec le jet de liquide enflammé… Il décrit aussi une exécution, mais toujours du côté humain, entre les derniers moments partagés avec le condamné jusqu’à l’exécution (page 177-178).
La force de Vildrac, c’est de toujours écrire sur son ressenti, sans tabou. Il évoque ainsi l’absence de désir sexuel chez les hommes (page 168), qu’il relie aux fatigues, aux épreuves.
Sa première permission arrive mais est reportée en raison de l’offensive de septembre 1915. Après avoir décrit les mauvaises impressions des premiers permissionnaires, il vit cette même expérience : l’arrière blasé de la guerre. Il a de grandes difficultés à savourer ces moments. Il montre l’écart entre le retour fantasmé et la réalité vécue. La vie est finalement plus simple, les réflexes de la vie civile sont retrouvés malgré 14 mois d’absence. Il vit très mal un repas avec des amis plus inquiets de leurs petits soucis personnels, un concert qui réveilla en lui des émotions profondes oubliées et sa colère après un poème de Paul Claudel. Il termine par une astuce pour gagner une journée de permission.
Le retour n’est pas plus facile car s’ouvre alors une période difficile où le permissionnaire est détaché de la réalité et des risques du front (page 184). Il est accueilli chaleureusement par ses camarades. Et à cette occasion il raconte sa seule joie : vivre au contact de la nature, ce qui transparaîtra dans ses Chants du désespéré. « J’ai pu jouir là, durant quelques jours, de l’un des rares avantages qu’offrait pour moi la guerre : vivre en pleine nature et particulièrement dans les bois, en forêt de Hesse ou d’Argonne. (…) J’ai aimé des bords de rivière et, de la tranchée même, de beaux ciels crépusculaires ou criblés d’étoiles ».
Page 210, il note « sur le parapet d’un boyau, je trouvai une anémone des bois ». Cet amour de la nature se retrouve dans la triste histoire du cheval Le Gris : on sent bien l’attachement de Vildrac aux humains comme à la nature. Avec le cheval, il arrive à nous faire sourire avant de partager sa tristesse sincère.
Au milieu des anecdotes sur les travaux de propreté, il évoque la blessure d’un officier d’artillerie par le célèbre « Zim-Boum » de Cheppy. Il ne s’empêche pas de critiquer l’héroïsme vu par la presse. Vildrac a rencontré une poignée de soldats « Impulsifs, braves – c’est-à-dire aimant à braver – , courageux, sans la conscience et la volonté du courage et promus héros quand ils étaient frappés à mort », page 184-185.
Le contraste est puissant avec les autres hommes côtoyés, civils arrachés à leur vie. Dans « Destins » page 204, il narre la mort de Jean Ruet dit Ramoulo qui fait pleurer toute l’équipe. Ses derniers instants, sa famille, l’inhumation, les attentions mais surtout toute la richesse humaine ressortent des mots de Vildrac.
Spectacle, changements dans l’équipe au fil des mois, Verdun, montrent que Vildrac va désormais plus vite dans ce qu’il écrit.
- Vildrac s’embusque (1917-1918)
Grâce à sa femme qui fit les démarches en secret, Vildrac est affecté à la Section de camouflage. Le jour même où il l’apprend, il participe à l’éreintant sauvetage d’hommes bloqués dans un abri éboulé par une explosion de torpille.
Son dernier jour est, oh combien, mémorable : c’est le jour où une énorme explosion de mine a enseveli une compagnie complète. La coulée de boue l’enterra vivant dans son abri alors qu’il soignait un sergent effrayé qui était un ancien instructeur du temps de son service actif. Il fut sauvé après des heures de travail par ses brancardiers et Paul qui venait lui apporter son ordre de départ.
Vildrac évoque ses sentiments, teintés de mélancolie, au moment de quitter ses camarades plongés dans les secours aux nombreux blessés de l’explosion de la mine.
« Le camouflage » s’intéresse au parcours de Vildrac une fois sorti du front. La guerre devient plus lointaine. Il cherche à éviter de retourner en unité combattante tout en restant proche d’amis artistes. On découvre le fonctionnement et l’organisation de cette structure particulière, à Paris comme dans la Zone des armées. Il décrit ses fonctions, ses amitiés, se remémore toujours autant d’anecdotes et nous permet de suivre un parcours bien plus complexe que ce que nous laisse imaginer sa fiche matricule.
Mais des mois entiers disparaissent de son récit. Plus important, il donne quelques clefs supplémentaires pour comprendre son œuvre. Il note particulièrement le retour de son envie d’écrire, de créer, au-delà des articles engagés qui ponctuent sa guerre et qui purent lui valoir quelques soucis. Il écrit les premiers vers de « Chant du désespéré ». La guerre l’avait tenu éloigné de cette forme de création, l’avait laissé dans un état de sidération, un quotidien annihilant tout sens à cette écriture. On ne peut voir cette « renaissance » dans son art que comme le fait qu’il ait vu le bout du tunnel, et par une volonté de témoigner croisée à une volonté de le faire dans son art.
Cette partie de sa campagne est plus brièvement évoquée, d’affectation en affectation, en France à Paris, en Italie jusqu’à sa démobilisation qui clôt ses souvenirs.
- L’omniprésence de la mort
Dès le baptême du feu, la mort rôde autour de l’auteur : camarades anonymes, mais aussi personnes connues de lui pour lesquelles il est plus sensible. Le premier exemple est celui de son cousin, des amis suivent dont Adler en février 1915.
Page 81, c’est à Varennes qu’un camarade en train de moudre du café sur une marche est décapité. Lui même échappe à la mort la même nuit quand il décide de quitter la grange où il dormait et qui était remplie d’obus. Le lendemain matin, la grange a été soufflée et les hommes qui y sont restés ont été tués. Page 82. Il est également hanté, des décennies plus tard par des morts croisés au cours de son parcours, plus particulièrement par celui assis confortablement avec une belle écharpe à Vauquois.
La mort, Vildrac y échappe de peu à plusieurs autres occasions : quand il entend siffler les balles lors de ses engagements, lors d’une explosion d’obus le 1er mars 1915 à Vauquois dont un éclat détruit le magasin de son fusil et un autre tue son voisin de droite. Même situation dans un combat de nuit : le caporal Vache est tué juste à côté de lui par une balle.
Autre anecdote d’un rendez-vous manqué avec la mort : il discute avec Vigerie autour d’une affaire d’avant-guerre. Ils prennent du retard pour le retour, ce qui les sauve : leur abri est détruit en leur absence à l’heure où ils auraient dû y être.
Il échappe une fois encore à la mort en se posant le dos contre un parapet pour discuter, mais où un creux au niveau du casque permettait à un tireur allemand d’envoyer des balles régulièrement. La balle arrive quelques secondes après qu’on l’ait fait se déplacer (page 105). Le dernier exemple de cette mort qui rôde se déroule lors d’une mission en Italie en 1918 avec son groupe de camoufleurs où l’artillerie reste une menace mortelle.
Si lui est sûr de n’avoir tué personne, il ne manque jamais l’occasion d’évoquer les conséquences de la mort donnée face à face. Ainsi, dans « Le petit soldat gris », il s’intéresse à celui qui a tiré. Il ne manque pas de décrire les effets psychologiques pour celui qui a vu l’homme touché par son action. « Le petit soldat gris » illustre le dilemme moral qu’est le fait de tirer sur un autre homme pour qui n’y est pas prêt : « Nous étions encore au début de la guerre, pas plus exercés à la faire qu’endurcis par elle », page 79.
Dans le même ordre d’idée, il critique page 115 le mythe de la baïonnette en racontant l’expérience du seul homme qu’il rencontra qui eut l’occasion de s’en servir et en resta hanté. Il évoque également, lors du retour dans la ligne de départ après un assaut infructueux à Vauquois le 28 février, le cas d’un homme qui eut la cuisse traversée par une baïonnette amie dans sa chute.
- Le pacifisme comme ligne directrice
Charles Vildrac ne témoigne pas d’un pacifisme militant. Par contre, il distille ce pacifisme tout au long de ses écrits, à la fois en évoquant des personnes talentueuses disparues à cause de la guerre, la mort d’anonymes dans son voisinage proche et par des avis tranchés contre les généraux plus que contre les pouvoirs politiques ou les autres officiers. Par exemple, « On ne dénoncera jamais assez le mensonge et l’imposture des éternels glorificateurs de la guerre qui affublent d’un héroïsme individuel toute victime d’un asservissement collectif » note-t-il. Il critique l’héroïsme créé par les communiqués et qui donne une image fantasmée de la guerre aux civils : « Selon les communiqués officiels si constamment inventifs et mensongers », page 121. Il poursuit en dénonçant les guides Michelin qui reprennent aveuglément ces récits pour en faire la mémoire du conflit.
Pages 129 à 131, Vildrac s’intéresse aux officiers : « dans le jeu de la guerre, il s’agissait de détruire les pions et non de s’en prendre aux joueurs placés de part et d’autre de l’échiquier, partenaires de même caste et de même rang » page 189 est une critique violente contre les officiers supérieurs qui font tuer les hommes en ordonnant des attaques, en faisant tirer au mortier sur l’ennemi alors que cela n’aura comme effet que de conduire l’ennemi à répliquer et à tuer des hommes. Il évoque aussi les officiers qui remettent les règles de la caserne une fois à l’arrière.
- En guise de conclusion
Au-delà du message, c’est avant tout un partage centré sur les autres, camarades, amis, hommes brièvement rencontrés. Tout est humain, tout en dénonçant l’absurdité de la guerre où tout est, au contraire, déshumanisé. La critique vis-à-vis des officiers supérieurs est liée à cela : des hommes qui prennent des décisions qui en condamnent nombre d’autres.
C’est une lecture indispensable pour mieux comprendre son recueil « Chants du désespéré ». Indispensable aussi car au-delà de l’aspect purement artistique, sa manière d’immortaliser ses camarades et la vie rend les mots très forts. Il y a du Galtier-Boissière dans la précision et l’immersion rendue par les anecdotes et du Mac Orlan dans la fluidité de la plume et la facilité à la lire. On peut aussi rapprocher Vildrac de Paul Geraldy ou plus encore de Jean Guéhenno, de Jean Paulhan ou de Louis Hobey. C’est à tout ce mouvement de dénonciation de la guerre et de pacifisme que se raccroche le présent ouvrage.
Pour ma part, il y eut un grand plaisir à parcourir ce témoignage dense, riche et si humain qui recoupe tant de thématiques, tout en offrant une plongée dans les années 1914-1916 au front puis en 1917-1918 dans les sections de camoufleurs.
- Remerciements :
A Stéphan Agosto pour m’avoir fait découvrir les deux ouvrages de cet auteur en un simple message sur Bluesky.
- Pour aller plus loin :
Chants du désespéré de Violdrac : compte rendu de lecture
VILDRAC Charles, Souvenirs militaires de la Grande Guerre, Paris, Éditions Claire Paulhan, 2021, 288 pages
https://www.clairepaulhan.com/catalogue/p/souvenirs-militaires-sur-la-grande-guerre-charles-vildrac
Il est recommandé de suivre le parcours de Charles Vildrac en parallèle avec l’historique du 46e RI afin de donner le contexte qui manque à l’auteur :
http://tableaudhonneur.free.fr/46eRI.pdf
- Archives de Paris :
D4R1 1181 : Fiche matricule de Messager Charles, classe 1902, matricule 2915 au bureau de recrutement de la Seine, 4e bureau.
D4R1 1685 : fiche matricule de Messager Fernand Maurice, classe 1912, matricule 1061 au bureau de recrutement de la Seine, 3e bureau.
https://archives.paris.fr/arkotheque/visionneuse/visionneuse.php?arko=YTo2OntzOjQ6ImRhdGUiO3M6MTA6IjIwMjUtMDMtMDQiO3M6MTA6InR5cGVfZm9uZHMiO3M6MTE6ImFya29fc2VyaWVsIjtzOjQ6InJlZjEiO2k6MTc7czo0OiJyZWYyIjtpOjE1NDUzNDY7czoxNjoidmlzaW9ubmV1c2VfaHRtbCI7YjoxO3M6MjE6InZpc2lvbm5ldXNlX2h0bWxfbW9kZSI7czo0OiJwcm9kIjt9#uielem_move=0%2C0&uielem_islocked=0&uielem_zoom=32&uielem_brightness=0&uielem_contrast=0&uielem_isinverted=0&uielem_rotate=F
- La gaize est une roche spécifique de Vauquois. Pour en savoir plus : http://www.jlargonnais.com/pages/nature/geologie/journees-nationales-de-la-geologie-2021-la-gaize-en-argonne-1.html ↩︎
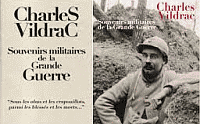
Retour de ping : Charles Vildrac – Une œuvre humaine au cœur d’une tragédie