MAUVIGNIER Laurent, La maison vide, Paris, Les éditions de minuit, 2025, 752 pages.
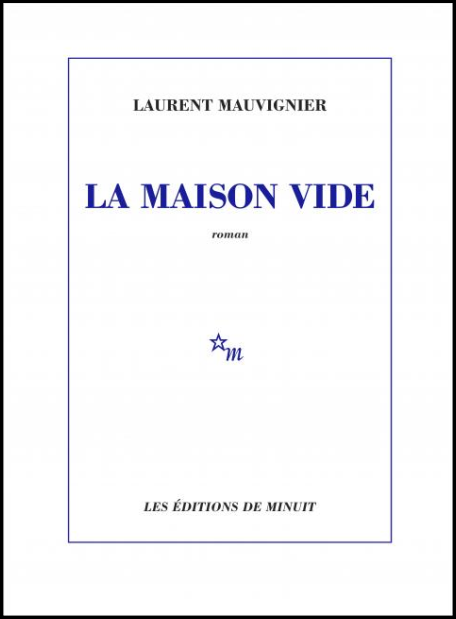
Nouveauté de la rentrée littéraire 2025 sortie la même semaine qu’Entre toutes de Franck Bouysse, cet ouvrage s’en démarque par sa taille : trois fois plus épais avec ses 752 pages. Franck Bouysse se penche sur un pan de son histoire familiale, à travers des parcours de femmes (sa grand-mère et son arrière-grand-mère) depuis la fin du XIXe siècle jusqu’à lui, en passant par les tragédies des Première et Seconde Guerres mondiales ; Laurent Mauvignier en fait de même. Mais quand Bouysse s’intéresse à une famille paysanne fort modeste, Mauvignier écrit sur une famille paysanne aisée qui cherche à faire sa place dans la bourgeoisie locale au risque de passer pour des parvenus.
Cet article a été réalisé avant le prix Goncourt de l’ouvrage. S’il évoque l’aspect très littéraire de l’œuvre, c’est surtout la vision donnée de la période de la Première Guerre mondiale qui est développée.
- L’art du conditionnel
Le volume de ce livre est à la fois sa force et sa faiblesse. En effet, que c’est long ! Chaque chapitre s’étire sur un fait, un événement de la vie de cette famille. Et l’auteur prend plaisir à la développer, à la nourrir de questionnements et de descriptions. Ce qui donne souvent l’impression qu’il noie le lecteur dans ses conjectures, que le tout manque d’efficacité. Toutefois, c’est aussi une preuve de la maîtrise du sujet par son auteur et de la qualité de sa plume. Loin des figures de style, c’est ainsi que Laurent Mauvignier nourrit son récit et qu’il forge son style. Tout est très détaillé. Et le lecteur suit car il n’y a pas de fausses notes. Tout est cohérent, réaliste.
Il ne faut pourtant pas oublier la méthodologie utilisée pour ce récit : c’est une histoire d’une branche de la famille de l’auteur. Il a puisé dans les souvenirs de famille, les documents conservés, les objets et les a replacés dans une maison fermée depuis des décennies, réceptacle symbolique ayant conservé toute la mémoire familiale depuis un siècle. Il y a donc un squelette dont on ne sait que trop bien qu’il ne représente qu’une infime partie de la vie et du cheminement ou des choix de chacun. L’auteur a brodé autour de ce squelette, mais de manière incroyablement développée. Il en a tiré un récit entre biographie historique et roman. Il fait parfois appel aux sources pour appuyer son propos. Chapitre 3, il explique sa démarche : « Ce monde, je pars de sa disparition pour le reconstituer, peut-être à l’aveugle, en prenant trop de libertés, mais avec la conviction que je le fais dans le bon sens, comme à partir du fémur fossilisé de squelette d’un animal préhistorique que personne n’a jamais vu ».
On devine la matière dont il dispose et on voit comment il disserte autour, invente tout en gardant le plus de réalisme possible en lien avec les usages et les mentalités de l’époque ou ce qu’il sait du caractère des uns et des autres. Les courriers et autres documents sont une aide précieuse. S’ajoute un talent d’écriture indéniable. D’autant qu’il n’affirme pas. Il reste au conditionnel. Il exprime régulièrement ses doutes même si ce n’est pas toujours explicite. Les « sans doute » sont présents, tout comme des formulations qui expriment le fait qu’il est dans l’interprétation et le roman des faits.
Il n’hésite pas à s’adresser directement au lecteur. Dans le cas qui suit, l’introduction du chapitre 43, il l’interpelle pour mieux justifier sa démarche.
« Imaginez : plutôt non, laissons-les à leur émotion et à la timidité, ou peut-être à l’effusion des retrouvailles. Laissons ce que nous pouvons à peine concevoir, cette scène banale rejouée des milliers de fois par des milliers d’hommes et de femmes à chaque guerre mais qui aujourd’hui me semble tellement lointaine et auréolée d’un tel mystère qu’elle me paraît impossible à esquisser ; ici, pour moi la main tremble, l’esprit se ferme, les images disparaissent, les voix s’éteignent, rien n’apparaît. » Il passe du « nous » au « je ». Il poursuit ensuite, malgré tout, sur ce qu’aurait pu être cette première journée pour mieux aborder la suite de son roman.
Il évoque parfois la documentation utilisée, qu’il recoupe avec les courriers, les souvenirs, donnant une matière pour lancer son imagination. Par exemple, dans le chapitre 9, il évoque ce qu’il a trouvé sur le professeur de piano : « On trouve une fiche assez détaillée le concernant, plutôt concernant le sergent Cabanel sur le site du ministère de la Défense, où l’on apprend que le professeur de piano a quarante-trois ans quand il part en 1914 servir sous les drapeaux, qu’il a donc treize ou quatorze ans de plus que Marie-Ernestine et qu’il est marié avec Marie-Clarté, née Redon, depuis déjà trois ans quand il débarque avec sa femme et ses beaux-parents au fin fond de la campagne. »
- Mais un livre qui reste pour beaucoup un roman
Si la trame est réelle, certaines personnes sont devenues des personnages largement fictifs. Le meilleur exemple est celui du père et de la mère de Marie Ernestine Proust.
Firmin Proust, décédé vers 1912 n’existe pas. Le père de Marie Marguerite (vrai nom de Marie Ernestine) était Paul Proust, né en 1855 et décédé en… 1929 ! Il a donc pu assister au second mariage de sa fille en 1921 et à la naissance en 1923 de son petit-fils. Ainsi, tout l’arc narratif autour du décès est-il imaginaire, tout comme celui autour du rôle de la mère, en particulier pendant la Première Guerre mondiale. En effet, Jeanne Rocher, née en 1860 est décédée à 24 ans en 1884, le 25 décembre, alors que sa fille est à peine âgée d’un an.
Les effets de réels dans les doutes qui parcourent le récit peuvent être, quand ils s’intéressent à un de ces personnages, une manière d’empêcher le lecteur de savoir ce qui est vrai et ce qui est inventé. Si l’intention de l’auteur reste sienne, il n’empêche que sa capacité à nous faire entrer dans les détails de ces vies est impressionnante.
- La Première Guerre mondiale dans ce livre
L’objectif n’est pas de faire l’étude de tout le livre. Dans le cadre de ce site thématique, je vais me focaliser sur ce que le livre nous dit de la Première Guerre mondiale et donc de la mémoire qu’en a l’auteur.
La guerre commence dans la partie III. Plus que dans les précédentes encore, l’auteur explique les incertitudes nombreuses qui font qu’il fait largement appel à l’imagination.
« Bien sûr, on ne sait rien de ce qui a pu se dire ni se vivre dans la famille de Jules comme dans celles de centaines de milliers d’hommes partis sur le champ de bataille ces jours-là. On ne saura jamais comment Jules a pu ou non étreindre sa femme, ni si l’un ou l’autre aura pleuré, s’ils auront pleuré ensemble, s’ils auront su ou pu inventer, avant le temps de leur séparation, une tendresse et un amour qui leur aura le plus souvent fait défaut le temps de leur union. On ne saura pas qui, des deux, aura le plus souhaité de courage à l’autre, de la chance, de la force, ni qui aura juré de faire de son mieux, que ce soit pour la France ou pour la maison. On ne sait rien de l’intimité qui chuchote dans les couloirs de l’histoire (…) » Ces mots extraits du chapitre 37 illustrent le travail de l’auteur. Il mène en parallèle un travail de réflexion qu’il partage avec le lecteur, mais il n’oublie pas d’insérer au milieu des éléments qui ramènent au cœur de l’intrigue de son histoire. L’effet est fort : on ne sait jamais ce qui est une certitude de ce qu’il a inventé ou romancé, donc une telle allusion dans des réflexions sur le réel intègre le roman dans le réel.
Il évoque d’abord longuement la mobilisation, avec tout ce qui est arrêté, en particulier la moisson. Il détaille le départ de Jules d’une maison où son épouse ne l’aime pas et ne veut pas prendre la suite de ses activités.
Cette troisième partie est courte. Elle s’organise autour de quatre grands thèmes :
– la mobilisation dans le chapitre 37. Tout tourne autour des inquiétudes de Jules qui doit partir.
– la place des femmes dans ce monde sans homme, chapitres 38 et 39.
– la correspondance entre Jules et Marie Ernestine, chapitres 40 et 41. Il développe quelques passages factuels sur le temps que Jules passa au dépôt.
– le retour en permission de Jules, chapitres 42 à 46. Après les interrogations de l’auteur sur ce qu’il peut imaginer, il décrit la première journée, la visite au village et aux autres habitants, la découverte pour Jules qu’il n’est plus utile car les femmes ont pris toutes les places. Le tout se termine sur la fin de la permission. Dans la partie IV, on démarre sur le monument aux morts. Il ne sera donc plus question de la Première Guerre mondiale que par allusions et observations de ses conséquences.
En effet, et cela a été dit très tôt dans le chapitre III, Jules est mort au combat le 18 mai 1916 Cote 304. À aucun moment l’auteur n’a essayé de développer le vécu de son mobilisé à la guerre. Il n’en a parlé que pour dire son incapacité à écrire sur cet indicible. Donc, on ne suit pas Jules ce 18 mai 1916 ou à aucun autre moment de sa présence au front. C’est un choix qui a le mérite d’éviter de tomber dans les pièges de ces mots qui ne sont que la représentation que l’auteur se fait de la guerre et non ce qu’elle a pu réellement être.
- Parcours militaire de Jules Chichery
La fiche matricule énonce des faits. Elle ne romance pas. Voici ce qu’elle nous apprend du parcours militaire d’un des protagonistes du livre, l’arrière-grand-père de l’auteur.
Il ne tira pas le bon numéro : il dut faire ses trois ans de service actif. Affecté au 68e RI, il devint caporal (16 décembre 1905). Quelques mois après sa libération le 12 juillet 1907, il se maria avec Marie Ernestine Proust (septembre 1907) et installa sa résidence à Marcé-sur-Esves. Il participa à ses deux périodes d’exercices, la première en novembre 1910, la seconde en avril 1912.
À la mobilisation, il eut un sursis. Certes, il arriva dès le 3 août au dépôt, mais il y resta jusqu’au 20 septembre 1914. Il rejoignit alors le régiment de réserve du 68e RI, le 268e RI. Il fut rapidement promu sergent au front. Il fut tué par balle le 18 mai 1916 alors que le 268e RI était durement engagé à la Cote 304 dans le secteur ouest de Verdun.
Ainsi, contrairement à ce que note Laurent Mauvignier dans le chapitre 43, non, Jules n’appartenait pas à l’armée territoriale. Appartenant à la réserve de l’armée d’active, la classe 1903 eut un rôle à tenir au front, tout comme de nombreux territoriaux envoyés en renfort en raison de la saignée de l’armée française de l’été 1914. Ses courriers attestent de son poste au dépôt, où il entraînait des territoriaux.
- En guise de conclusion
Ce livre a une saveur particulière. L’art d’imprégner le lecteur, de le pousser à le suivre dans cette plongée dans la vie de ses personnages est remarquable. Cependant, quels que soient les artifices utilisés par l’auteur, ce texte reste un roman construit sur une structure vraie. Il tisse une toile romancée sur les drames familiaux réels qui parsèment un siècle d’histoire.
Que l’on soit un lecteur qui adhère aux longues énumérations et aux développements autour de chaque événement ; que l’on soit un lecteur qui comprend vite l’étape de vie que chaque chapitre mais apprécie moins tout ce qui est écrit autour qui peut sembler répétitif voire remplissage littéraire ; quelle que soit sa manière de lire ce livre, il ne laisse pas indifférent à la maîtrise de l’écriture ou au savoir-faire qui a permis d’immerger le lecteur dans une histoire et le foisonnement de ses détails.
Pour ce qui est de la Première Guerre mondiale, on est loin des poncifs mémoriels que l’on trouve dans trop de publications récentes (mutineries, héroïsme de cinéma, fusillés…). Il ne s’agit pas pour autant d’un roman centré sur cette période même si elle est une étape importante avec le décès d’un protagoniste. On y trouve surtout une description d’une permission et de certaines conséquences du conflit.
- Remerciements
Ne suivant pas les nouveautés littéraires, je serais passé à côté de cet ouvrage sans le signalement de Cécile M. Grand merci à elle.
À Thibaut Vallé qui a retrouvé la trace de la généalogie de l’auteur.
- Pour en savoir plus
Lire les premiers chapitres sur le site de l’éditeur :
https://www.leseditionsdeminuit.fr/livre-La_Maison_vide-3486-1-1-0-1.html
Avis de critiques littéraires :
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/le-masque-et-la-plume/la-maison-vide-de-laurent-mauvignier-5734612
